Jean-Jacques Hofstetter - Un demi-siècle de création en partage
En juin 1975, Jean-Jacques Hofstetter organise sa première exposition dans son atelier de la rue de la Samaritaine. C’est le début d’une aventure de cinquante ans à la tête de l’Atelier-Galerie Jean-Jacques Hofstetter.
Dans "Un demi-siècle de création en partage", Charly Veuthey raconte ces cinquante ans d’activités. Sous la forme d’une biographie, il se penche non seulement sur le galeriste, mais aussi sur l’artiste, créateur de bijoux et de sculptures.
Le livre emmène ses lecteurs à la rue de la Samaritaine, à la rue des Épouses, dans les expositions personnelles de Jean-Jacques Hofstetter, dans l’espace public où il a réalisé de nombreuses œuvres, en Basse-Ville où il a toujours vécu et bien sûr au Canada, où il a fait de nombreux voyages.
Tout un pan de la vie artistique fribourgeoise des cinquante dernières années apparaît en filigrane. Du Groupe mouvement aux jeunes créateurs fribourgeois d’aujourd’hui, en passant par les artistes suisses et internationaux qui ont exposé chez lui, on rencontre toute une galerie de personnages qui ont pu faire connaître leurs oeuvres grâce à l’engagement de Jean-Jacques Hofstetter et qui lui ont, en retour, transmis la flamme qui l’a animé tout au long de sa carrière.
"Un demi-siècle de création en partage" est le portrait d’une personnalité marquante de la ville de Fribourg qui séduit autant par ce qu’il est que par ce qu’il a apporté à l’art fribourgeois.100 + 100
200 ans d’histoire en 100 duos inédits
La baleine, le tigre, le rhinocéros ? une plante, un cristal, un fossile? Dans les collections du Musée d’histoire naturelle de Fribourg, quel est votre objet favori?
Dans ce livre commémoratif, des visiteurs et visiteuses de tous âges mais aussi des personnalités du monde scientifique, culturel ou politique répondent à cette question. Immortalisés avec leur objet coup de cœur, les protagonistes se dévoilent et racontent l’histoire qui les lie à leur pièce de collection préférée.
Les 100 personnes et les 100 objets au cœur de cet ouvrage représentent symboliquement les 200 ans d’histoire du Musée fondé en 1824. A travers des photographies originales et des textes très variés, vous découvrirez 100 témoignages qui reflètent de manière touchante ce qui fait l’essence du Musée : la rencontre de ses précieuses collections scientifiques avec les personnes pour qui ces trésors comptent.
Ce livre du bicentenaire sera accompagné d’une exposition qui se tiendra au Musée d’histoire naturelle de Fribourg du 17 mai 2024 au 9 février 2025.
Photographies
Laurent Crottet a travaillé pendant 30 ans comme photographe de presse. Aujourd’hui photographe indépendant, il se consacre en particulier au reportage, au portrait et à l’architecture.
Aldo Ellena est photographe de presse pour le quotidien Freiburger Nachrichten. En tant que photographe indépendant, il est actif entre autres dans les domaines du reportage, de la nature et du paysage.
Textes
Jean-Philippe Bernard est journaliste et travaille entre autres pour le quotidien La Liberté. Il est curateur et membre de la commission artistique du Festival International du Film de Fribourg.
Carole Schneuwly est historienne et journaliste. Elle travaille depuis 2021 dans les domaines de l’administration et de la communication au Musée d’histoire naturelle de Fribourg.
Hors Jeu
Comment les parents des sportives et sportifs d’élite vivent-ils et accompagnent-ils la carrière de leurs enfants? Quels défis doivent-ils relever pour les aider à répondre aux exigences de leur sport?
Mère d’un hockeyeur professionnel, Eliane Brügger Jecker a décidé de coucher ses réflexions sur papier. Estelle Leyrolles, dont un des deux fils est basketteur dans l’élite, s’est jointe à elle dans l’écriture de ce livre à quatre mains.
Les deux femmes livrent avec beaucoup d’humanité leur singulier parcours, dans l’idée de le partager avec d’autres parents soumis aux mêmes exigences. Leur propos dépasse le domaine du sport, pour mettre en lumière, avec beaucoup de sensibilité, la force des liens familiaux.
Elles donnent aussi la parole à d’autres parents qui vivent des parcours similaires.
Dans la dernière partie de l’ouvrage, des sportives et des sportifs témoignent de la manière dont ils ont été accompagnés par leurs parents au fil de leur carrière:
Andrei Bykov, Marielle Giroud, Mathilde Gremaud, Ian Gut, Benoît Jecker, Robin et Aloïs Leyrolles, Ellen et Léa Sprunger, Julien Sprunger.
Eliane Brügger Jecker est psychologue-psychothérapeute. Elle travaille dans un cabinet privé à Fribourg et contribue à la formation postgrade et continue pour les psychologues et psychothérapeutes de Suisse romande.
Estelle Leyrolles, ingénieure puis cadre dans l’industrie, elle dirige l’École des Métiers de Fribourg. Elle œuvre dans le milieu associatif (Sporteki.com, Hurdler.fr) et a cofondé l’association GateToFuture (g2f.ch), réseau de sportives et sportifs d’élite à Fribourg.
Mein Bild – Dein Bild – Unser Bild
Der Freiburger Verlag Éditions faim de siècle freut sich, anlässlich des 70. Geburtstags von Beat Fasel ein zweisprachiges und reich bebildertes Werk herauszugeben. Es zeigt das 50-jährige Schaffen des Sensler Künstlers auf einzigartige Art und Weise: Die abgebildeten Werke sind mit persönlichen Kommentaren ihrer jeweiligen Besitzerinnen und Besitzer versehen. Dadurch entsteht ein spannender Dialog zwischen den Werken und den dazugehörigen Texten.
Der Kunsthistoriker Walter Tschopp beschreibt im Vorwort des Buches die erzeugte Wirkung folgendermassen: "Das Resultat ist erstaunlich. Es wird damit fassbar, wie unglaublich verschieden Annäherungen an die Kunst sein können. Oft fassen die Kommentare die Spannung, die das erstandene Bild zum Leben des jeweiligen Besitzers enthält: Erinnerungen, Analogien zu selbst Erlebtem […]."
Der künstlerische Weg von Beat Fasel führte ihn von der abstrakten Malerei der 1970er-Jahre über Geometrisierungen, Landschaftsbetrachtungen und einer gestischen und zeichenhaften Malerei zum neuen Genre des Color Field Painting und darüber hinaus.
Die beeindruckende Sammlung der im Buch enthaltenen Werke ist so zugleich ein beredtes Zeugnis für die Entwicklung der Malerei seit 1950.
Bâtir fribourg au 20ème siècle – la ville – 1950-2000
Édité par la SIA Fribourg, ce magnifique ouvrage de 415 pages est rédigé en français et allemand par Christoph Allenspach et Aloys Lauper, historiens et collaborateurs du Service des Biens Culturels de Fribourg.
Ce livre vous invite à découvrir le bâti de la seconde moitié du 20e siècle à travers 104 réalisations emblématiques, de l’aubette aux grands ensembles, en passant par les aménagements urbains, les réhabilitations d’immeubles et les nouveaux matériaux.
Vous prendrez du plaisir à porter un regard neuf sur des objets construits remarquables ou mêmes disparus qui participent au patrimoine ou à l’histoire du développement du bâti de qualité à Fribourg.
Les prochaines éditions du Recensement de l’Architecture Contemporaine (RAC) consacrées aux autres régions fribourgeoises sont déjà prévues pour compléter cet ouvrage.
Commande
A l’aide du bulletin de commande sur le site de la SIA, vous pouvez commander cet ouvrage au prix de Fr. 80.– (étudiant·e : Fr. 40.–).
Le film de minuit
Lancé en janvier 1984 au moment où la Télévision suisse romande se décide à étendre les programmes du week-end sur la deuxième partie de soirée, Le film de minuit fut d’abord une case bouche-trou, avant de devenir une véritable institution pour toute une frange de cinéphiles romands y ayant trouvé une identité.
Au départ constituée de films anciens ayant déjà été diffusés, la programmation de cette case horaire, déplacée pour la saison estivale de la même année le mercredi soir à une heure de grande écoute, marque une première incursion dans le cinéma de genre, où la TSR diffuse des œuvres fantastiques et horrifiques sous l’appellation Le grand frisson.
Une seconde impulsion, définitive cette fois-ci, allait se profiler à la période de Pâques 1985 : La nuit des loups-garous, soirée mythique dont tous les adolescents de l’époque se souviennent comme ayant été la véritable inspiration d’un programme désormais dévoué à des œuvres réservées à un public averti.
Vitrine d’un cinéma transgressif peuplé d’œuvres aujourd’hui culte, Le film de minuit allait sans le savoir se profiler comme un véhicule précurseur pour des cinéastes tels que Mario Bava, Brian De Palma ou John Carpenter, à une époque où leur cinéma n’était pas encore reconnu comme celui de véritables auteurs.
Le présent ouvrage retrace la première décennie de l’émission, encore existante près de 40 ans après son lancement. Calendrier exhaustif des 417 films diffusés durant cette période, analyse critique détaillée de chaque œuvre et anecdotes piquantes : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Le film de minuit se trouve désormais entre vos mains…
Tombé dans la marmite du cinéma à l’âge de quatre ans, Julien Comelli est, depuis trois décennies, critique cinéma dans différents médias romands, tant dans la presse écrite que radiophonique. Chroniqueur sur les ondes de La Première (RTS), cet érudit produit également en parallèle des documentaires sur le Septième Art pour plusieurs éditeurs vidéo français.
Corpus – Le corps isolé
Le livre évoque différents aspects de l’histoire culturelle autour du corps isolé abordé dans des articles par des historien-nes, un philosophe, des théologiens, une historienne de l’art.
Les sujets abordés sont riches et intéressants: environnement carcéral, choix d’une vie monastique, fétichisation contemporaine des objets conçu comme des cocons d’une vie mystérieuse, pratiques umériques et risques d’enfermement… Le livre comprend également deux entretiens avec l’abbé d’Hauterive, Marc de Pothuau, et avec l’artiste Abrabah Poincheval.
Ces articles sont complétés par des notices d’œuvres révélant les lieux, les protagonistes et les objets au centre du lien entre corps et isolement.
Ce livre est réalisé dans le cadre de l’exposition CORPUS - Le corps isolé au Musée d’art et d’histoire de Fribourg (25.11.2022 – 26.02.2023).
Auteurs
Ivan Mariano, Marc de Pothuau, Jacques de Coulon, Alix Heiniger, Pau-Bernard Hodel, Anne-Françoise Praz, Abraham Poincheval et Caroline Schuster Cordone.
Caractéristiques
Format: 17x24cm
Page: 165
Parution: janvier 2023
ISBN: 978-2-940707-19-5
Un couple et sept couffins (eBook)
Bookmaker d’un seul pari, je n’imaginais pas écrire au pluriel et réitérer un accident de parcours de balayeur survenu il y a déjà six ans.
Un couple et sept couffins est la présentation profuse et badine de chapitres thématiques et d’anecdotes révélant une famille helvétique de tradition urbaine composée d’un père prolétaire, d’une mère au foyer ainsi que de leurs sept enfants grandissant.
Un carmel au XXe siècle - Le monastère du Pâquier en Suisse
Sur les hauteurs du village du Pâquier, en face de la colline de Gruyères et des premiers sommets des Préalpes, se trouve le monastère du Carmel du Pâquier. Installées dès 1936 dans cette oasis de verdure, des moniales contemplatives vivent là selon les règles définies au XVIe siècle par Thérèse d’Avila. L’histoire de cette communauté carmélitaine avait commencé quelques années plus tôt à Lully, dans la Broye fribourgeoise. Et c’est pour commémorer ce centenaire de l’installation de ce premier carmel en terres helvétiques que la communauté et l’Association des Amis du Carmel du Pâquier ont souhaité éclairer ce parcours.
Il fallait le grand talent de François Walter pour rendre toute la richesse d’une histoire aux apparences immobiles, tant la mission des religieuses est orientée vers la contemplation et la prière. Professeur émérite de l’Université de Genève et auteur de nombreux ouvrages, dont une récente Histoire de la Suisse en cinq tomes, l’auteur a travaillé les riches archives du monastère et de l’Évêché, des chroniques inédites, des échanges épistolaires pour en tirer un ouvrage passionnant. Il dévoile les péripéties de la fondation dans un pays encore marqué par les conséquences du Kulturkampf, dessine le portrait de moniales engagées, éclaire les périodes où l’évolution s’accélère à l’image des remous que provoque la réception de Vatican II au sein de la communauté.
Immobile, l’histoire du Carmel du Pâquier ? Au contraire. Voilà une communauté qui, sous le signe de la fidélité créatrice, vit pleinement avec son temps.
Une étude historique richement illustrée, réalisée par le professeur François Walter.
Sur le pont
Un film de Sam et Fred Guillaume
Un livre de Josiane Haas
Deux visions sur la mort
Le film : Des femmes et des hommes voyagent à bord d’un train sans destination dans lequel le temps semble suspendu.
Le livre : Des femmes et des hommes accompagnent le passage ou l’approchent par leur travail artistique.
Toutes et tous racontent leur expérience, leurs questionnements et leur manière d’envisager ce départ.
Le film et son making of sont accessibles via un code QR figurant dans le livre.
Seeland
Ce livre accompagne l’exposition éponyme présentée au Musée de Morat du 12 juin au 25 septembre 2022.
À la manière d’une enquête, Tomas Wüthrich a sillonné, appareil photographique en main, le Seeland. Avec ses images, l’artiste nous emmène à la découverte d’un territoire chargé d’histoire, invite à voyager à travers le temps, de la mer préhistorique à celle de plastique. Une façon poétique et délicate de sensibiliser à la transformation du paysage ainsi qu’à la perte de la biodiversité.
Le Seeland, qui englobe les lacs de Neuchâtel, de Morat et de Bienne, est une région au cœur de l’actualité. Connue pour être le plus grand potager de Suisse, elle entend développer son potentiel au cours des prochaines décennies afin de répondre aux demandes grandissantes en matière de bien-être, de durabilité et de préservation des ressources environnementales. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.
Longtemps, cette région s’est composée de deux zones distinctes : celle des villages lacustres attestés dès la Préhistoire, ainsi que celle du Grand-Marais, humide, inondable, insalubre, et donc peu propice à l’habitat. Source d’angoisses mais aussi d’espoirs, elle a bénéficié des corrections des eaux du Jura (1868-1891 et 1962-1973) qui ont généré de significatifs effets d’entraînement, faisant de ce terrain malpropre un potager d’importance nationale. En moins de 150 ans, l’image du Seeland s’est ainsi bonifiée, et les souffrances d’antan semblent de nos jours appartenir à un passé révolu.Or, le Seeland est une région en perpétuelle mutation, millénaire et fragile dans laquelle coexistent des ressources naturelles remarquables et des activités socio-économiques intenses. Et demain ? Le temps est aux interrogations.
Dans ce livre, Tomas Wüthrich invite à regarder le Seeland autrement ainsi qu’à repenser certains enjeux sociétaux tels que notre manière de considérer la nature et l’environnement. Ses images soigneusement composées donnent à voir un imaginaire onirique qui renvoie, avec intelligence et talent, aux frontières du monde visible et du monde intérieur.
Isabelle Krieg – Ruinaissance
La publication « Isabelle Krieg - RUINAISSANCE » bilingue (fr/all) et richement illustrée évoque les points forts de la création d’Isabelle Krieg des dernières années et présente un choix de travaux récents.
L’artiste aux origines fribourgeoises questionne notre regard sur le monde, par le biais d’installations et d’œuvres mêlant réflexions philosophiques, humour et sujets sociétaux. Les thèmes abordés sont le passage du temps, la poésie décalée du quotidien, notre rapport au corps, et surtout notre lien vital à la planète.
Vérossaz
Le 27 juin 1822, Vérossaz accède à l’autonomie communale. Pour commémorer ce bicentenaire, un livre retrace aujourd’hui les huit siècles de présence humaine sur le territoire de la commune.
Un portrait de Vérossaz, à la fois singulier et ouvert au monde, y est brossé par cinq historiens et historiennes. Cet ouvrage, richement illustré, aborde les origines de la communauté médiévale, les permanences et les changements de l’Époque Moderne, la quête d’indépendance des années 1818-1822 ainsi que le développement de la commune durant les deux derniers siècles.
Ce livre met en lumière l’histoire de Vérossaz et de sa population d’une manière inédite. Tout amoureux de l’histoire locale pourra y reconnaître des noms de lieux et de familles connus mais aussi découvrir de surprenants éléments du passé.
Disponible dès le 27 août
HEIA-FR - 125 ans d'histoire: un regard vers l'avenir
Durant toute l’année 2021, la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg a organisé un grand nombre de manifestations pour fêter ses 125 ans. Un blog a raconté cette belle et longue histoire.
Les textes de ce blog historique ont été réunis dans le livre HEIA-FR – 125 ans d'histoire : un regard vers l'avenir qui sortira de presse en septembre. Des débuts, en 1896, jusqu’à nos jours, celle qui s’est d’abord appelée École de métiers, puis Technicum cantonal, puis École d’ingénieurs de Fribourg a formé des générations d’ingénieur e s qui ont largement contribué au développement du canton.
Le livre revient sur la création de l’École à un moment où Fribourg souhaitait ardemment entreprendre son industrialisation. Il dresse le portrait des grandes figures qui ont marqué l’institution : Léon Genoud, François Hemmer et les autres directeurs qui se sont succédé à la tête de l’établissement. Il accorde également une large place à l’évolution des disciplines enseignées et aux professeur e s qui ont porté ces révolutions successives destinées à répondre, à chaque époque, aux nouveaux défis technologiques du temps. Il montre aussi le rôle important, au cours des 25 dernières années, de la HEIA-FR et de son secteur Ra&D pour l'innovation dans le canton.
Il raconte enfin la vie quotidienne de l’institution, les développements du quartier de Pérolles que l’école n’a jamais quitté depuis sa fondation, les liens étroits qu’elle a toujours entretenus avec les entreprises du canton et son inscription dans le paysage des hautes écoles suisse.
Nous vous proposons de commander le livre pour le prix de souscription de CHF 28.– + frais de port, jusqu’au 30 juin. Le livre sera ensuite vendu en librairie au prix de CHF 38.–.
Attention: cette offre ne s’adresse pas aux collaboratrices, collaborateurs et étudiant-e-s de la HEIA-FR qui bénéficieront d’une offre spéciale qui leur sera proposée à la rentrée de septembre.
Charly Veuthey et Lisa Roulin, HEIA-FR — 125 ans d’histoire : un regard vers l’avenir, 208 pages, nombreuses illustrations, Éditions Faim de Siècle.HTA-FR - Eine 125-jährige Geschichte: Zukunft als Mission
Während des ganzen Jahres 2021 hat die Hochschule für Technik und Architektur Freiburg eine Vielzahl von Veranstaltungen organisiert, um ihr 125-jähriges Bestehen zu feiern. Zudem wurde ihre wunderbare und lange Geschichte in einem Blog nachgezeichnet.
Die Texte dieses Blogs werden im Buch HTA-FR – Eine 125-jährige Geschichte: Zukunft als Mission zusammengefasst, welches im September erscheinen wird. Von ihren Anfängen im Jahr 1896 bis heute hat die Schule – die erst Kunst- und Gewerbeschule, dann Kantonales Technikum und später Ingenieurschule Freiburg hiess – ganze Generationen von Ingenieurinnen und Ingenieuren ausgebildet, die einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Kantons geleistet haben.
Das Buch geht auf die Gründung der Schule ein, zu einem Zeitpunkt, als der Kanton Freiburg nach seiner Industrialisierung strebte. Es stellt die grossen Persönlichkeiten vor, die die Institution geprägt haben: Léon Genoud, François Hemmer und die anderen Direktoren, welche die Schule geleitet haben. Es legt den Fokus auf die Entwicklung der unterrichteten Fächer und die Professorinnen und Professoren, welche diese Entwicklungen vorangetrieben haben, um auf die neuen technologischen Herausforderungen der jeweiligen Zeit zu reagieren. In den vergangenen 25 Jahren war die HTA-FR mit ihrem Bereich aF&E ein wichtiger Innovationsträger im Kanton.
Das Buch erzählt auch vom Alltag an der Schule sowie von den Entwicklungen im Pérolles-Quartier, dem die Schule seit ihrer Gründung stets treu geblieben ist, den engen Beziehungen zu den Unternehmen des Kantons sowie ihrer Einbettung in die Schweizer Hochschullandschaft.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das Buch zum Subskriptionspreis von CHF 28.- + Versandkosten bis zum 30. Juni zu bestellen. Danach wird das Buch im Buchhandel zum Preis von CHF 38.- verkauft.
Achtung: Dieses Angebot gilt nicht für Mitarbeitende und Studierende der HTA-FR, die ab Anfang September von einem Sonderangebot profitieren können.
Charly Veuthey und Lisa Roulin, HTA-FR — Eine 125-jährige Geschichte: Zukunft als Mission, 208 Seiten, zahlreiche Illustrationen, Éditions Faim de Siècle.
1698/t-t: une distance, deux terres
Le livre 1698/t-t documente le superbe projet international au format expérimental qui a contribué à former de manière aléatoire des binômes d’artistes italo-suisses. Initié en août 2019 par Valeria Caflisch, 1698/t-t tire son nom des 1698 kilomètres séparant les duos d’artistes.
Outre les œuvres produites, l’intérêt du projet réside dans le choix de la méthode. À la manière d’une rencontre Tinder, les duos se sont formés après une phase d’envois anonymes d’images et de messages. Des premières discussions à distance aux voyages, la collaboration s’est ensuite développée de manière organique et exponentielle.
À travers installations, vidéos et œuvres visuels, les intervenants explorent, entre collaboration et cocréation, les notions de mobilité et d’échange. Artistes: Valeria Caflisch (coordination); Laura Malerba (documentation); Francesco Balsamo & Isabelle Pilloud; Marcella Barone & Christiane Hamacher; Primula Bosshard & Alessandra Schilirò; Gianluca Lombardo & Ivo Vonlanthen.
Curateurs invités: Valentina Barbagallo & Philippe Clerc.
Dès le matin au Carmel
La Communauté du Carmel du Pâquier célèbre cette année le centième anniversaire de l’installation des premières Carmélites en Suisse, en terre fribourgeoise.
C’est en automne 1921 qu’une première communauté de Carmélites, venues de Narbonne, s’installe dans le petit château de Lully, dans la Broye fribourgeoise. Quelques années plus tard, en 1936, elle se déplace au Pâquier où un monastère construit en pleine nature et face au décor majestueux des Préalpes les accueille.
L’Association des Amis du Carmel, forte de plus de 620 membres souhaite marquer ce centenaire par la publication de deux ouvrages destinés à mieux faire connaître le Carmel du Pâquier, dans sa vie actuelle et dans son histoire. Ainsi, ce premier livre de photographies propose le regard de la photographe gruérienne Mélanie Rouiller sur la vie carmélitaine actuelle, regard complété de textes du poète et écrivain Jean-Dominique Humbert.
Corpus
Le livre éclaire les relations passionnantes entre le corps et le sacré en évoquant notamment les « images à manger » reliant le croyant au sacré par l’incorporation, le corps du diable et ses couleurs, sous la plume de Michel Pastoureau, des réflexions philosophiques autour du lien entre le corps, la chair et le sacré avec Alexandre Jollien.
La publication évoque aussi le lien entre le mouvement et les sculptures, la question du corps «désincarné» par sa mise en extase ou sa fragmentation dans l’art des reliques.
En dialogue avec ces textes sont réunies des présentations consacrées à des œuvres de la collection du Musée d’art et d’histoire de Fribourg qui rappellent combien le corps et le sacré peuplent notre imaginaire, notamment par les figures d’Adam et Eve, de la Vierge, du le lien entre corps et sacré continue d’inspirer des artistes contemporains qui en soulignent les survivances et les décalages en mettant en scène de surprenants épidermes, poupées, figures orgiastiques ou vêtements détournés.
Ce livre a été réalisé dans le cadre de l’exposition CORPUS - Le corps et le sacré au Musée d’art et d’histoire de Fribourg (26.11.2021 – 27.02.2022).
Auteurs
Stephan Gasser, Alexandre Jollien, Jérémie Koering, Ivan Mariano, Michel Pastoureau, Caroline Schuster Cordone.
Notices : Adeline Favre, Jade Marie D’Avigneau, Damien Spozio, Alexandra Walker.
Un couple et sept couffins
Bookmaker d’un seul pari, je n’imaginais pas écrire au pluriel et réitérer un accident de parcours de balayeur survenu il y a déjà six ans.
Un couple et sept couffins est la présentation profuse et badine de chapitres thématiques et d’anecdotes révélant une famille helvétique de tradition urbaine composée d’un père prolétaire, d’une mère au foyer ainsi que de leurs sept enfants grandissant.
Voyage à travers le paysage muséal valaisan
Le canton du Valais connait l’une des plus grandes densités de musées du pays. La diversité des collections qui y sont abritées témoignent de coutumes séculières, des temps passés, d’artisanat traditionnel et de l’attachement à la terre. Du travail du minerai à l’art contemporain, ce sont autant de témoignages des petits et grands événements, cycliques ou ponctuels, qui amènent le monde dans la vallée du Rhône et ses couloirs latéraux.
L'Association Valaisanne des Musées, fondée en 1981, vous propose un voyage dans le paysage muséal valaisan, des premières institutions des XVIIIe et XIXe siècles à nos jours, et vous fait mieux comprendre ses principales activités: développement d’un inventaire en ligne des collections des musées du canton, coordination de la Nuit des Musées valaisanne ou encore collaboration à la récente exposition collective Destination collection qui a présenté plus de 1000 objets issus de près de 40 collections muséales.
Dans la partie catalogue de l’ouvrage, 40 institutions muséales ont sélectionné à l’occasion des 40 ans de l’association un objet de leur collection pour le présenter au public. De la stèle néolithique au chapeau traditionnel, du reliquaire médiéval à la photo de famille, les objets les plus divers vous entraînent dans la richesse du patrimoine muséal valaisan.
Bilingue fr/all : coéditeur Hier+ Jetzt, pour l’espace germanophone.
Nombre de pages : 150 pages
Format : 20 x 28 cm
Médias
Photos libres de droit pour usage médiatique en lien avec ce livre.< Mention du copyright indiqué obligatoire.
Photos libres de droit du Gardemuseum et du Zermatter Museum. Mention du copyright indiqué obligatoire.
Galerie de pensées joyeuses
La première exposition virtuelle permanente de pensées.
- Âne: Il est impossible de faire admettre à une personne de mauvaise foi qu’elle a raison.
- Contresens: Dans un sens interdit, on ne peut dépasser qu’en reculant.
- Égocentrisme: Autoportrait avec un tas d’objets posés sur moi est une œuvre de Bernard Buffet.
- Incohérence: Les créationnistes pensent que la Terre est plate, mais pas leur cerveau.
- Orthographe: Selon l’Académie française, Smiley s’écrit : rond jaune-yeux-sourire.
Rupture
Un dialogue fécond et inspirant entre art contemporain et écriture autour de la notion de "rupture".
D’une extrême richesse, ce terme ouvre un champ des possibles, questionné par les oeuvres de plusieurs artistes fribourgeois invités par le Musée d’art et d’histoire de Fribourg.
Coupure, séparation, cassure, interruption, fêlure, cette notion n’existe pas sans la présence d’un lien préalable… un avant, un pendant, un après. Elle interroge notre être. Elle touche nos imaginaires.
Des textes d’auteurs entrent en résonance avec les oeuvres de l’exposition et invitent à poursuivre la réflexion.
Livre réalisé dans le cadre de l’exposition "Rupture - Bruch" au Musée d’art et d’histoire de Fribourg (07.05 – 19.09.2021)
Fribourg Olympic - Toujours plus haut (1961- 2021)
Au cœur de la vie d’Olympic
Il y a 60 ans, le 27 avril 1961, Fribourg Basket et Olympic Basket unissaient leur force pour fonder Fribourg Olympic Basket avec le succès que l’on connaît.
Une équipe d’anciens d’Olympic et de passionnés, parmi lesquels plusieurs journalistes sportifs, a décidé de faire paraître un ouvrage en octobre 2021 pour faire revivre cette belle épopée sportive.
Ce livre de grand format, richement illustré, reviendra bien sûr sur les exploits sportifs du club, mais il s’attardera aussi sur les coulisses et les personnes qui ont permis à cette véritable institution du basket suisse de traverser toutes ces années : grands personnages, grands joueurs, bénévoles... tout le monde sera au rendez-vous au fil des pages.
D’anciens joueurs et entraîneurs – parmi lesquels Patrick Koller, Pascal Perrier-David, Duško Ivanović ou encore Rick Bullock – et d’anciens présidents prendront aussi la plume pour dire leur amour pour leur club.
Il y aura du sport et un vrai esprit de fête au fil des pages de ce livre incontournable pour les amoureux d’Olympic.
Sortie: fin octobre 2021
Gabby Marchand - Je me souviens... Fribourg
Ce livre est à la fois un témoignage historique sur le Fribourg de la jeunesse de Gabby Marchand et une œuvre de prose poétique complétée par des textes que le chanteur-poète a consacré à sa ville et à son canton. Gabby Marchand s’en explique dans la préface de son livre.
"Je me souviens de ce mercredi 29 mars 1989 à l'Opéra-comique de Paris. J'assistais au spectacle du comédien-acteur Sami Frey juché sur un vélo et je me délectais de la prose poétique de Georges Perec et de ses "je me souviens".
Depuis ce jour, j’ai eu envie d’écrire mes propres "je me souviens". Georges Perec avait lui-même repris l’idée des "I remember" du poète anglais Joe Brainard.
Ce livre est un concentré du Fribourg de ma jeunesse.
Le souvenir n'étant pas une science exacte j'entends déjà des voix s'élever pour me contredire et cette idée me réjouit.
Je me souviens d'une des premières chansons de Johnny Hallyday Souvenirs, souvenirs. Il était très jeune.
Gabby Marchand a fait toute sa vie "le chanteur". Gabby Marchand est un arbre. Il pourrait être comme le marronnier sous lequel il a passé les plus belles années de son enfance en l'Auge. Le tronc: ces chansons qu'il appelle "mes nécessités". Les branches: des excursions vers des mondes de beauté. A 76 ans, il n'a rien perdu de sa passion et ce livre est pour lui un vrai bonheur.
Hollywood Trip
Dans cet ouvrage délirant, Patrick Ramuz (critique cinéma officiel de Radio Fribourg) passe à la moulinette vingt-cinq blockbusters américains sur le ton de la parodie et de l’absurde.
En revenant très librement sur les histoires de ces films, il dessine un portrait psychédélique du cinéma hollywoodien, connu autant pour son efficacité que pour son manichéisme.
Ce livre s’adresse à tous les passionnés ou amateurs de cinéma qui pourront s’amuser à revisiter différemment ces grands succès du box-office dont les héros font désormais partie de la culture populaire.
L’auteur
Fribourgeois d’origine mais Nord-coréen d’adoption depuis 237 jours, Patrick Ramuz est né à Bâle en 1971. Après avoir décroché un titre de vice-champion du monde junior de natation désynchronisée, il décide de devenir comique et se lance donc dans une formation juridique.
En 1999, son rêve se réalise : il monte sur la scène de l’Etat de Fribourg en tant que juriste. Il y jouera pendant vingt ans son spectacle hilarant, « Pas d’égalité dans l’illégalité ». Durant son temps libre, il s’adonne à sa véritable passion : le cinéma. De 1997 à 2003, il est ainsi engagé dans plusieurs films suisses comme cascadeur. Victime d’une luxation au poignet droit au cours d’une scène d’action dans un carnotzet, il est contraint de quitter définitivement les plateaux de tournage. Dès lors, il va se consacrer à l’écriture, publiant deux livres à compte d’auteur, Reflets du cinéma américain: 1970-2005 (2007) et Journal d’un cinéphile - Why so serious? (2011).
Depuis 1998, Patrick Ramuz est le critique cinéma officiel de Radio Fribourg.
Héroines
Ce livre raconte les femmes qui nous inspirent et nous encouragent. Il exprime l’utopie d’un monde meilleur.
Isabelle Pilloud a une main de velours dans un gant de fer. Elle présente une œuvre artistique toute de finesse mise au service d’une vision sans équivoque: les femmes doivent pouvoir se libérer de tous les carcans qui leur sont imposés.
Inspirations
Dans ce livre, Tatjana Erard s’inspire de la vie d’Emmanuel Schmutz et de ses passions – le cinéma, la photo et la littérature – pour peindre, par très fines touches, le portrait d’un homme.
Le livre est divisé en 13 chapitres incisifs, tout en maîtrise. Tatjana Erard joue des genres littéraires au fil des pages : scénarios, interviews, récits se succèdent pour rythmer l’ouvrage.
L’auteure s’est longuement entretenue avec Emmanuel Schmutz. Puis elle a imaginé ce qu’il n’avait pas voulu, pas pu ou pas eu le temps de dire dans ces interviews. C’est donc une magnifique biofiction que Tatjana Erard donne à lire.
Vernissage
Le vernissage d’Inspirations aura lieu le jeudi 14 novembre dès 17h à la librairie Banshees'bookshop dans le pub du même nom (rue d’Or 5, Fribourg)
Table bleue
Ce livre s’est imposé comme une évidence pour un troisième volume de la collection « La vie des gens ». Il s’agit d’un recueil de propos d’une grande humanité recueilli au fil des jeudis à la table du café social du Tunnel, à Fribourg.
Baptiste Oberson dit avec beaucoup de finesse toutes ces vies qui défilent, qui se croisent et qui se rencontrent, parfois, dans un café. Le café est un personnage à part entière du livre.
"Je viens ici tous les jeudis matin, avec ma machine à écrire. Sur la table, je pose un mot : ouvert. J’accueille ce que les gens ont à partager. J’essaie d’être visiblement disponible, bien qu’occupé à écrire.
L’activité sert de porte d’entrée, la machine encourage la discussion :
– Euh, ça existe encore ? ou
– C’est une Hermès?
– J’avais la même en vert."
Il existe une édition limitée numérotée, agrémentée d'une gravure originale de Baptise Oberson, disponible ici
Table bleue - Edition numérotée
Edition limitée numérotée (30 exemplaires), agrémentée d'une gravure originale de Baptiste Oberson
Ce livre s’est imposé comme une évidence pour un troisième volume de la collection « La vie des gens ». Il s’agit d’un recueil de propos d’une grande humanité recueilli au fil des jeudis à la table du café social du Tunnel, à Fribourg.
Baptiste Oberson dit avec beaucoup de finesse toutes ces vies qui défilent, qui se croisent et qui se rencontrent, parfois, dans un café. Le café est un personnage à part entière du livre.
"Je viens ici tous les jeudis matin, avec ma machine à écrire. Sur la table, je pose un mot : ouvert. J’accueille ce que les gens ont à partager. J’essaie d’être visiblement disponible, bien qu’occupé à écrire.
L’activité sert de porte d’entrée, la machine encourage la discussion :
– Euh, ça existe encore ? ou
– C’est une Hermès?
– J’avais la même en vert."
La Garde Suisse Pontificale au cours des siècles
Qui mieux qu’un garde féru d’histoire pour retracer la vie d’une institution plus de cinq fois centenaire au service unique de la Papauté? Garde pontifical de 1993 à 2008, le sergent Christian Richard a, durant ses années romaines au cœur du Vatican, étudié avec passion la grande et la petite histoire de cette armée née au cœur de la Renaissance et de ses luttes sanglantes.
Ce livre évoque, en deux parties, l’histoire de la Garde de Jules II à François, puis le fonctionnement du Corps et ainsi que la vie quotidienne des gardes au cours des siècles. Une très riche iconographie permet une immersion dans ce cadre fascinant.
Préface du conseiller fédéral Alain Berset
288 pages - 24x30cm
Écrit par Christian Richard
Disponible en librairies (dans la limite des stocks disponibles)
Le baliseur sauvage
Alain Monney est le baliseur sauvage.
Sans demande ni autorisation, il plaque ses balises colorées sur les abribus, les clôtures, les façades, les poteaux, les arbres ou les piles des ponts.
Il trace ainsi, dans un art dosé du jeu et de la contrainte, de nouveaux itinéraires à découvrir, qui sont autant d’invitations à la marche, au rêve et à la poésie, espiègle et physique.
Groupe Mouvement
En 1957, cinq copains artistes s’associent pour créer le Groupe Mouvement à Fribourg, où il n’existe alors pas de galerie. Ils ont la volonté de donner accès à l’art au plus de gens possible. Pendant plus de 50 ans, Mouvement organise des dizaines d’expositions, soutient de jeunes talents, expose des artistes venus de nombreux pays, promeut l’art sous toutes ses formes et propose des œuvres accessibles à toutes les bourses. Témoignage de cette période, cet ouvrage a pour but non seulement de rendre hommage à ces artistes, mais aussi de donner accès à leur travail. Avant-gardistes, les membres du groupe n’ont pas tous fait d’importantes carrières et sont, pour certains, restés un peu dans l’ombre.
Historien de l’art formé à l’Université de Fribourg, Philippe Clerc a travaillé pour la maison de vente aux enchères Christie’s avant d’entrer au service de différents collectionneurs suisses et internationaux. Spécialiste de la peinture suisse des XIXe et XXe siècles, il a notamment fait des recherches sur Corot en Gruyère, mais également sur les élèves de Ferdinand Hodler à Fribourg et Genève.
Crécelle et ses brigands
Le roman des onze jours vides du calendrier
L’adoption du calendrier grégorien par les catholiques a créé un curieux décalage temporel. Ainsi, on vit à des jours différents selon que l’on se fie au Pape ou à la Réforme.
À Genève, pour remettre les pendules à l’heure, on débute l’année 1701 le 12 janvier. Mais que faire de ces onze journées inexistantes ? Crécelle, jeune servante, trop timide pour affronter la vie, décide d’utiliser ce temps qui n’appartient à personne pour écrire sa propre histoire.
Dans sa quête maladroite, elle croise le chemin de quelques hors-la-loi patentés pour qui ces onze jours seront l’occasion de manœuvres bien moins innocentes.
Au tournant mou du XVIIIe siècle, entre un Roi d’Espagne agonisant et un Roi de France au règne trop long, Michaël Perruchoud tisse un roman historique rond en bouche et riche en saveurs et en rebondissements.
Le succès de Crécelle et ses brigands marqua le début de l’œuvre littéraire protéiforme de Michaël Perruchoud. Recherché et introuvable, l’ouvrage ressort aujourd’hui, 20 ans après, dans une version (légèrement) revue par l’auteur. Michaël Perruchoud est né à Genève en 1974.
Crécelle et ses brigands - eBook
Le roman des onze jours vides du calendrier
L’adoption du calendrier grégorien par les catholiques a créé un curieux décalage temporel. Ainsi, on vit à des jours différents selon que l’on se fie au Pape ou à la Réforme.
À Genève, pour remettre les pendules à l’heure, on débute l’année 1701 le 12 janvier. Mais que faire de ces onze journées inexistantes ? Crécelle, jeune servante, trop timide pour affronter la vie, décide d’utiliser ce temps qui n’appartient à personne pour écrire sa propre histoire.
Dans sa quête maladroite, elle croise le chemin de quelques hors-la-loi patentés pour qui ces onze jours seront l’occasion de manœuvres bien moins innocentes.
Au tournant mou du XVIIIe siècle, entre un Roi d’Espagne agonisant et un Roi de France au règne trop long, Michaël Perruchoud tisse un roman historique rond en bouche et riche en saveurs et en rebondissements.
Le succès de Crécelle et ses brigands marqua le début de l’œuvre littéraire protéiforme de Michaël Perruchoud. Recherché et introuvable, l’ouvrage ressort aujourd’hui, 20 ans après, dans une version (légèrement) revue par l’auteur. Michaël Perruchoud est né à Genève en 1974.
Hors-Saison
Je ne sais pas combien de minutes se sont écoulées avant que je comprenne que tu n’es pas simplement endormi sur le canapé. Que la porte d’entrée est ouverte et que l’air frais n’a rien à voir avec l’isolation quasi inexistante.
Trois minutes, peut-être. Dix de plus sans doute pour réaliser que tout est à sa place, tes cigarettes, ton téléphone, tes clefs, ton portefeuille.
Mais pas toi.
Audrey Bertschy, 33 ans, revient sur la disparition mystérieuse de son compagnon par une nuit d’hiver glaciale. Un témoignage poignant et vivant.
Hors-Saison - Version eBook
Je ne sais pas combien de minutes se sont écoulées avant que je comprenne que tu n’es pas simplement endormi sur le canapé. Que la porte d’entrée est ouverte et que l’air frais n’a rien à voir avec l’isolation quasi inexistante.
Trois minutes, peut-être. Dix de plus sans doute pour réaliser que tout est à sa place, tes cigarettes, ton téléphone, tes clefs, ton portefeuille.
Mais pas toi.
Audrey Bertschy, 33 ans, revient sur la disparition mystérieuse de son compagnon par une nuit d’hiver glaciale. Un témoignage poignant et vivant.
Cuba Libre
"Tu as épargné le prix d’une course. De quoi t’offrir une pute. Choisis la mignonne et gamine. Ou encore mieux un servant de messe, tout frais sorti de sa première communion.
Maurice-Guillaume Boniek est un curieux amalgame de Pologne, d’Espagne et de Valais. Garagiste appliqué, il forme avec Brigitte le plus étrange des couples. Pour échapper à sa famille – véritable gynécée oppressant – et reconquérir sa belle, Maurice-Guillaume tente un voyage de noces en solitaire. Commence alors un périple halluciné dans un Cuba crépusculaire à l’extrême fin des années 90. La libido longtemps brimée de Maurice-Guillaume survivra-t-elle aux explorations de ce faux touriste dans cette singulière île des tentations ?
Cuba Libre - eBook
"Tu as épargné le prix d’une course. De quoi t’offrir une pute. Choisis la mignonne et gamine. Ou encore mieux un servant de messe, tout frais sorti de sa première communion.
Maurice-Guillaume Boniek est un curieux amalgame de Pologne, d’Espagne et de Valais. Garagiste appliqué, il forme avec Brigitte le plus étrange des couples. Pour échapper à sa famille – véritable gynécée oppressant – et reconquérir sa belle, Maurice-Guillaume tente un voyage de noces en solitaire. Commence alors un périple halluciné dans un Cuba crépusculaire à l’extrême fin des années 90. La libido longtemps brimée de Maurice-Guillaume survivra-t-elle aux explorations de ce faux touriste dans cette singulière île des tentations ?
Et si...
Chaque jour, nous vivons notre environnement bâti, notre logement, notre ville, sans porter forcément attention à tous les éléments construits qui les composent. Et si nous y réfléchissions de plus près? Que fait ce socle de béton à cet endroit précis sur le chemin de mon école? Pourquoi ce terrain de détente est-il plat? Où s’arrêtent les pinacles de la cathédrale ?
Le projet et si… veut soulever ces questions de manière simple et visuelle en présentant des paires d’images qui renvoient chacune au même lieu précis de notre environnement direct dépeint sous deux aspects contrastés : un état existant et un état modifié.
La juxtaposition de deux états d’un même lieu entend interroger la temporalité, l’identité ou la potentialité de ce qui constitue notre environnement. Le traitement formel identique d’un état à l’autre permet une interprétation libre de leur chronologie.
Cette confrontation visuelle suscite des questionnements. Qu’est-ce qui était là avant ? Qu’adviendra-t-il de cela ? Qu’est-ce qui serait là maintenant si… ?
De l’architecte, du peintre et de la nécessité de penser ce qui ne peut être fait
Le projet et si… cherche à faire le pont entre l’architecte et le peintre qui sont en Samuel Rey, entre le prospectif et le descriptif, entre ce qui existe et ce qui pourrait ou aurait pu exister. Il veut pousser l’un à penser hors de sa parcelle et l’autre à peindre au-delà de ce qu’il voit.
D’une démarche personnelle à une démarche participative et évolutive
Bien que le projet et si… soit d’abord une démarche personnelle, celle-ci souhaite pousser à une réflexion collective. Les images proposées ne sont en aucun cas des projets aboutis, mais bien des incitations à s’interroger sur notre environnement construit, à y réfléchir ensemble…
Samuel Rey, Architecte EPFZ et artiste peintreGiétro 1818. Une histoire vraie
Après Giétro 1818. La véritable histoire, le deuxième tome de l’histoire de la débâcle du barrage bagnard Giétro 1818. Une histoire vraie arrive dans les librairies.
Le premier racontait le déroulement des événements, en s’attachant à établir les faits sur la base d’une masse importante d’archives et de documents encore inédits.
Le deuxième volet s’interroge plutôt sur l’impact de cette histoire : les traces qu’elle a laissées dans les mémoires et dans le paysage, puis la façon dont elle s’est transmise.
«Une catastrophe est toujours un bouleversement», relève l’auteur, l’anthropologue Mélanie Hugon-Duc. «Chacun élabore un récit qui reflète un point de vue et qui n’est jamais neutre».
Parmi ce foisonnement de récits, on retrouve des témoignages de voyageurs, de notables locaux, de scientifiques notamment.
«La débâcle survient dans un contexte très particulier », souligne l’anthropologue. Sur fond de développement des sciences et d’évolution du climat, l’intervention de personnages d’une stature exceptionnelle, comme Perraudin ou Venetz, confère à cette histoire une résonance internationale.
Loin de se résumer à une catastrophe naturelle locale, cet épisode prend ainsi place dans l’histoire mondiale des sciences. «C’est l’un des aspects qui expliquent l’ancrage profond de ce récit dans le cœur des Bagnards, comme élément de leur patrimoine», résume Mélanie Hugon-Duc.
Fri
"Si t’as "fri",t’as tout compris!"
Dans le canton de Fribourg, une multitude d’entreprises et d’associations ont eu le même coup de génie. Elles ont décidé d’utiliser le préfixe "fri" dans leur nom.
Écrit à une dizaine de mains, ce livre leur rend hommage.
C’est un annuaire absurde et c’est un réquisitoire contre le manque d’imagination.
Jamais contents!
Si le public aime sa RTS, il arrive parfois que le contenu d’une émission fasse l’objet d’une réclamation ou d’une plainte de la part d’un auditeur ou d’un téléspectateur. C’est à ce moment-là qu’entre en jeu un médiateur.
Évoqués avec humour, les cas présentés dévoilent les coulisses de ces étranges négociations hors micros et caméras. Ils nous montrent surtout la relation passionnée et passionnelle du citoyen avec son service public et illustrent le fonctionnement de la communication audiovisuelle.
Emmanuel Schmutz, ancien adjoint du directeur de la BCU de Fribourg, a été médiateur pour la RTS à côté de ses activités professionnelles consacrées à l’enseignement et à l’animation culturelle dans le domaine des médias, de la photographie, du cinéma et du patrimoine audiovisuel.
Prends et provoque ta parole en public
Ce livre est un manuel de formation pour conquérir le leadership par la force de la parole en public.
Maxime Morand, théologien et philosophe de formation, après une carrière de DRH, conduit des activités de conseil en matière d'humains en ressources, sous le vocable de Provoc-Actions.
Evangile des idées reçues
Après plusieurs recueils d’aphorismes, Marc Boivin (Les Dicodeurs) explore le chemin des croyances improbables, qui passe aussi par la Suisse. Il livre un nouvel assortiment de trouvailles absurdes, joyeusement illustrées par son vieux complice Olivier Zappelli (Planches à ressasser).
Evangile des idées reçues - eBook
Après plusieurs recueils d’aphorismes, Marc Boivin (Les Dicodeurs) explore le chemin des croyances improbables, qui passe aussi par la Suisse. Il livre un nouvel assortiment de trouvailles absurdes, joyeusement illustrées par son vieux complice Olivier Zappelli (Planches à ressasser).
Giétro 1818. La véritable histoire
Des mots et des hommes
Recueil des chroniques publiées par Maxime Morand dans la presse, agrémentées d’un ovni, sous la forme d’un alphabet du leadership, ce livre fusille les leaders toxiques et les départements de ressources humaines.
Aux yeux de l’ancien membre de la direction de Lombard Odier, les responsables des ressources humaines sont obnubilés par des concepts creux. Ils sont utilisés par leur hiérarchie pour faire avaler d’amères pilules aux collaboratrices et aux collaborateurs des entreprises, qui sont dominés par des chefs de lignes improbables et des responsables des finances tout puissants.
C’est en amoureux des humains en ressources, pour reprendre son expression, qu’il essaie de réfléchir à un avenir utile pour les professionnels du management et des ressources humaines.
Porté par l’humanisme et l’humour, ce livre est un véritable traité de sagesse à destination de nous tous qui œuvrons au sein d’organisations multiples. Il nous donne des clés fécondes pour une lecture décalée de notre vie professionnelle. Pour reprendre les mots de Franklin Servan-Schreiber dans sa préface "il nous aide à reconnaître les marqueurs d’une vie professionnelle vraie et réussie."
Fribourg(s)
Une trentaine d’écrivains sur la ligne de départ, douze à l’arrivée : le livre que vous tenez entre vos mains est le fruit d’un concours d’écriture lancé par la Société fribourgeoise des écrivains en 2016. L’idée était qu’après Fribourg la Secrète, dernier recueil collectif édité par nos soins, ni la ville ni le canton n’avaient révélé tous leurs secrets. Charge à notre société de les débusquer!
Ces nouveaux secrets, dans un esprit de dialogue entre les arts, nous les avons partagés avec une poignée d’illustrateurs d’ici et d’ailleurs. Leurs images créent un contrepoint visuel à des histoires tantôt poétiques, tantôt axées sur l’intrigue.
Derrière la boulangerie
Une rue de Fribourg dans les années trente et quarante : les parents s’affairent dans la boulangerie, la maison déborde de neuf enfants, de personnel et d’activités. Anne-Marie est la plus jeune. Dans cette fourmilière, elle grandit. À l’odeur du pain, se mêlent les éclaboussures de la guerre, les événements inattendus et les étonnements.
Dans cette maison, Anne-Marie ne comprend pas tout. Elle comprendra plus tard, bien plus tard.
Anne-Marie Francey est née à Fribourg, il y a 85 ans. Ce livre est le récit autobiographique de son enfance et de son adolescence. Un récit de force, de foi et d’espoir.
Derrière la boulangerie - eBook
Une rue de Fribourg dans les années trente et quarante : les parents s’affairent dans la boulangerie, la maison déborde de neuf enfants, de personnel et d’activités. Anne-Marie est la plus jeune. Dans cette fourmilière, elle grandit. À l’odeur du pain, se mêlent les éclaboussures de la guerre, les événements inattendus et les étonnements.
Dans cette maison, Anne-Marie ne comprend pas tout. Elle comprendra plus tard, bien plus tard.
Anne-Marie Francey est née à Fribourg, il y a 85 ans. Ce livre est le récit autobiographique de son enfance et de son adolescence. Un récit de force, de foi et d’espoir.
Un aller simple pour Nova Friburgo
Deux mille. Ils furent près de deux mille à quitter la Suisse en 1819 en quête d’une vie meilleure après la terrible année 1816 sans été qui ravagea les campagnes d’Europe. De Fribourg surtout, mais aussi du Jura, du Valais, de Vaud, de Genève, de Neuchâtel et de Suisse alémanique, hommes, femmes et enfants se mirent en route. Après avoir vendu tous leurs biens, ils gagnèrent le Rhin, puis la mer du Nord pour entreprendre la périlleuse traversée de l’Atlantique.
Au Brésil, près de Rio de Janeiro, une colonie leur était promise par le roi du Portugal. Près d'un quart des émigrants trouva la mort durant ce tragique voyage sans retour.
À travers ce roman et le destin d’Henri Cougnard, c’est bien l’histoire tourmentée de ces Suisses qui tentèrent l’aventure et créèrent non sans peine Nova Friburgo que raconte Henrique Bon.
Henrique Bon (1952) est né à Nova Friburgo au Brésil, dans une famille issue de cette émigration suisse du XIXe siècle. Bercé par les récits familiaux de cette épopée, il a consulté pendant de nombreuses années les archives historiques existantes pour nous offrir cette aventure humaine. Il a publié ce roman au Brésil en 2008.
Traduction de Robert Schuwey
Un aller simple pour Nova Friburgo - eBook
Deux mille. Ils furent près de deux mille à quitter la Suisse en 1819 en quête d’une vie meilleure après la terrible année 1816 sans été qui ravagea les campagnes d’Europe. De Fribourg surtout, mais aussi du Jura, du Valais, de Vaud, de Genève, de Neuchâtel et de Suisse alémanique, hommes, femmes et enfants se mirent en route. Après avoir vendu tous leurs biens, ils gagnèrent le Rhin, puis la mer du Nord pour entreprendre la périlleuse traversée de l’Atlantique.
Au Brésil, près de Rio de Janeiro, une colonie leur était promise par le roi du Portugal. Près d'un quart des émigrants trouva la mort durant ce tragique voyage sans retour.
À travers ce roman et le destin d’Henri Cougnard, c’est bien l’histoire tourmentée de ces Suisses qui tentèrent l’aventure et créèrent non sans peine Nova Friburgo que raconte Henrique Bon.
Henrique Bon (1952) est né à Nova Friburgo au Brésil, dans une famille issue de cette émigration suisse du XIXe siècle. Bercé par les récits familiaux de cette épopée, il a consulté pendant de nombreuses années les archives historiques existantes pour nous offrir cette aventure humaine. Il a publié ce roman au Brésil en 2008.
Traduction de Robert Schuwey
Forain Forever, Pour une goutte de vin, il faut bien descendre
Nihil novi sub sole: les montagnards valaisans de la rive gauche ont toujours lorgné les vignes de la plaine et des coteaux ensoleillés. La culture de leur vigne et de leur vin loin du foyer a rythmé les travaux et les jours, les va-et-vient saisonniers de milliers de familles. Depuis des siècles, cette transhumance singulière existe, de l’Entremont vers Fully, de Salvan vers Plan-Cerisier, d’Isérables vers Leytron, de Nendaz vers Conthey et Vétroz, d’Evolène et d’Hérémence vers Sion, d’Anniviers en région sierroise ou de Tourtemagne, d’Eischoll et d’Unterbäch vers Salquenen.
Dans les vieux documents historiques, on qualifiait de "forains" ces nombreux propriétaires de vigne qui n’étaient pas des habitants du lieu. Le terme s’est connoté au cours des âges, et n’évoque plus guère aujourd’hui qu’une catégorie fiscale. Les bouleversements d’après-guerre ont rendu caduque en apparence cette économie qui dictait ces rituels et ce nomadisme saisonnier. Mais est-ce vraiment le cas? N’est-ce pas aussi notre regard qui change ?

Avec son approche historique et ethnographique, ce livre propose une analyse fine, comme un vin bien décanté, de ce phénomène. Les auteurs évoquent ces liens tissés par les usages entre Anniviers et Sierre d’une part, entre les communautés de l’Entremont et celle de Fully d’autre part. Analyses historiques, portraits attachants, architecture des mazots, documents d’archives et objets qui ont traversé les siècles : l’alternance des genres et des approches permet une lecture gourmande de ce livre en pièces détachées. Dans le cas de Fully et de l’Entremont, une micro-histoire d’une extrême richesse est mise en exergue pour la première fois sur le long terme, depuis les premières sources médiévales jusqu’aux exemples contemporains. Une histoire "totale", qui quantifie un phénomène pressenti, ne se contente pas de la vulgate orale colportée par les générations et fait rendre tout le jus d’archives anciennes. Elle ne néglige ni l’économie, ni la politique, et toutes les tensions communautaires. Bonne dégustation!
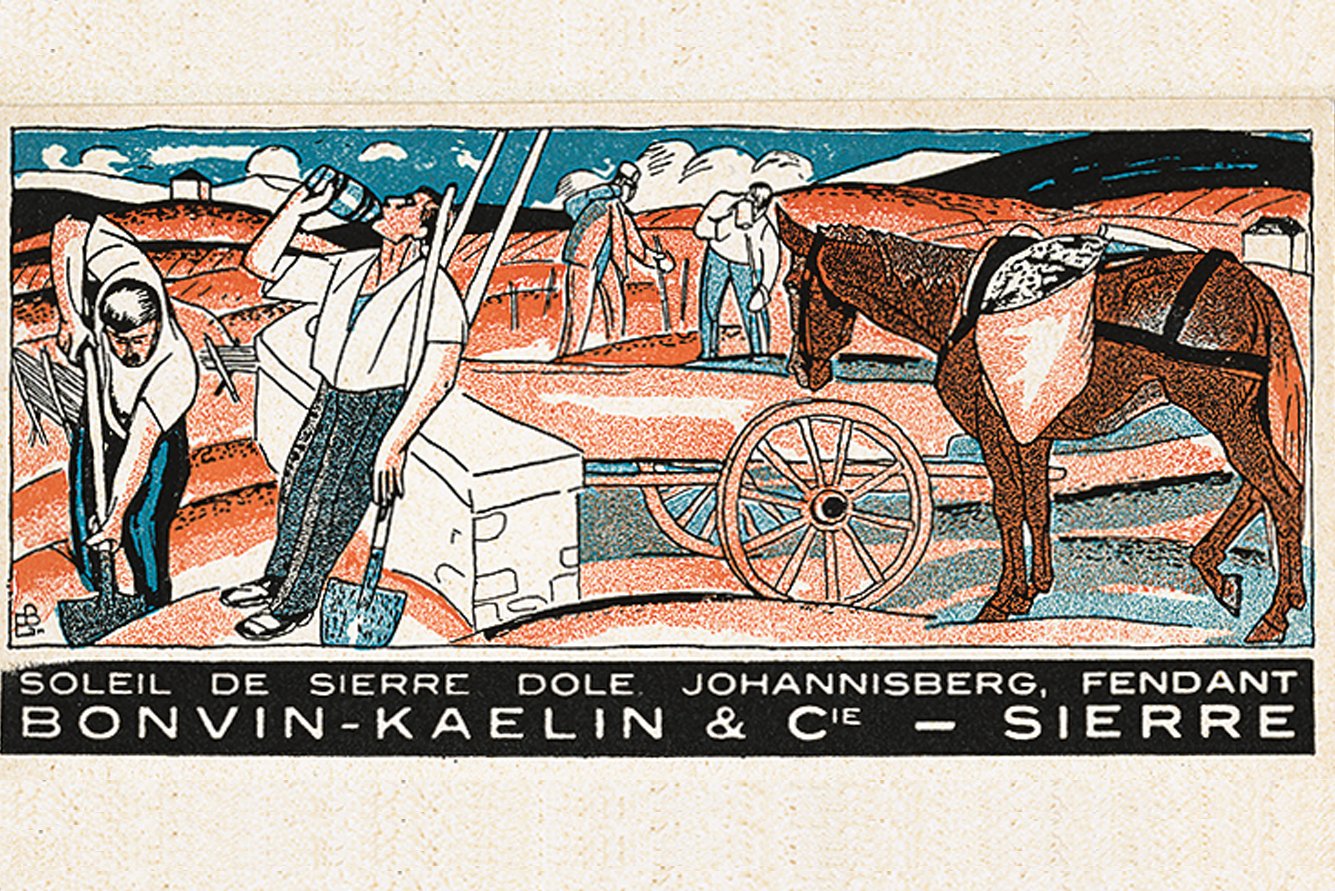
Images (scénettes): Deux scénettes liées aux Anniviards et à leur vigne: vignolage, travail de la vigne, vendanges, trinquer au vin nouveau. Lithographies de petite taille signées Edmond Bille destinées à illustrer des menus pour Bonvin-Kaelin & Cie, (années 1920). Copyright: Association Edmond-Bille
Au cours de leur recherche, les historiens du bureau Clio Christine Payot et Arnaud Meilland ont découvert dans les archives communales de Fully, déposées aux Archives cantonales, de riches listes nominatives de propriétaires du XVIIe siècle et XIXe siècles. Ils les ont retranscrites. Destinées à permettre l’encaissement de l’impôt, elles nous offrent aujourd’hui un portrait presque exhaustif des propriétaires d’Entremont dans le vignoble de Fully, et ceci dès 1668. La masse des laborieux viticulteurs n’est plus anonyme et l’histoire s’incarne, humblement.
La première liste de 1688 offre déjà plus de 500 noms. C’est durant ce siècle que le phénomène des forains d’Entremont propriétaires à Fully explose. Les individus sont classées par paroisse d’origine, puis par prénom. (source : AEV, AC Fully L 30).
La deuxième liste de 1851 présente le phénomène quasiment à son apogée. Le nombre de forains d’Entremont, plus de 1300, dépasse le nombre des habitants du Fully d’alors ! (Source : AEV, AC Fully L 73, L 78, L 79)
Télécharger les listes [PDF]
Dans la presse
L'Echo Illustré [PDF]Le Nouvelliste [PDF]
Gazette de Fully [PDF]
Retour dans l’Est
Six ans après son très remarqué Best-Seller (2011), qui a également été traduit en allemand et édité chez Rotpunkt Verlag, Isabelle Flükiger publie son cinquième roman, le deuxième chez Faim de Siècle.
Dans ce roman elle part sur les traces de sa mère, à Bucarest.
Accompagnée de cette dernière, elle découvre le pays d’origine de la branche maternelle de sa famille, pays dont elle n’avait qu’un vague souvenir d’enfance. À travers ce voyage se déploie toute la vie de sa mère et de ses ancêtres: on plonge au cœur de la Roumanie de Ceaucescu, mais on explore surtout le destin des juifs roumains, dont sa mère a fait partie. Isabelle Flükiger raconte aussi ses grands-parents, qui choisirent finalement de s’exiler vers Israël.
C’est toute une histoire familiale qui se révèle dans ce texte où l’auteur se dévoile plus que jamais. Retour dans l’Est est une magnifique saga familiale et un livre superbe qu’une fille offre à sa mère. L’ouvrage est porté par la précision de la langue d’Isabelle Flükiger et par ce ton inimitable qui a fait son succès.
"C’est un voyage mère-fille dans la terre d’origine de la mère, terre qu’elle a reniée, mais dont elle garde un accent plein de «r» roulés qui la complexent, et que je n’entends pas, et tous ses souvenirs d’enfance. Elle a passé maintenant bien plus d’années dans ce petit village de Suisse que dans sa Bucarest natale et elle déteste qu’on lui demande d’où elle vient. Mais même si, comme beaucoup d’immigrés, elle est plus patriote que ceux du cru, elle reste marquée par la provenance, et les odeurs, et tout ce qu’elle a appris là-bas, année après année jusqu’à ce qu’elle s’en aille. C’est pour ça que j’ai voulu ce voyage. Parce que cet accent et cette altérité sont la musique de mon enfance; c’est eux qui m’ont guidée vers l’âge adulte, et pourtant, je ne les perçois pas."
Isabelle Flükiger s’est révélée avec Du ciel au ventre (2003, éd. L’Age d’homme); elle a ensuite publié Se débattre encore (2004, éd. L’Age d’homme) et L’Espace vide du monstre (2007, éd. de l’Hèbe).
Retour dans l’Est - eBook
Six ans après son très remarqué Best-Seller (2011), qui a également été traduit en allemand et édité chez Rotpunkt Verlag, Isabelle Flükiger publie son cinquième roman, le deuxième chez Faim de Siècle.
Dans ce roman elle part sur les traces de sa mère, à Bucarest.
Accompagnée de cette dernière, elle découvre le pays d’origine de la branche maternelle de sa famille, pays dont elle n’avait qu’un vague souvenir d’enfance. À travers ce voyage se déploie toute la vie de sa mère et de ses ancêtres: on plonge au cœur de la Roumanie de Ceaucescu, mais on explore surtout le destin des juifs roumains, dont sa mère a fait partie. Isabelle Flükiger raconte aussi ses grands-parents, qui choisirent finalement de s’exiler vers Israël.
C’est toute une histoire familiale qui se révèle dans ce texte où l’auteur se dévoile plus que jamais. Retour dans l’Est est une magnifique saga familiale et un livre superbe qu’une fille offre à sa mère. L’ouvrage est porté par la précision de la langue d’Isabelle Flükiger et par ce ton inimitable qui a fait son succès.
"C’est un voyage mère-fille dans la terre d’origine de la mère, terre qu’elle a reniée, mais dont elle garde un accent plein de «r» roulés qui la complexent, et que je n’entends pas, et tous ses souvenirs d’enfance. Elle a passé maintenant bien plus d’années dans ce petit village de Suisse que dans sa Bucarest natale et elle déteste qu’on lui demande d’où elle vient. Mais même si, comme beaucoup d’immigrés, elle est plus patriote que ceux du cru, elle reste marquée par la provenance, et les odeurs, et tout ce qu’elle a appris là-bas, année après année jusqu’à ce qu’elle s’en aille. C’est pour ça que j’ai voulu ce voyage. Parce que cet accent et cette altérité sont la musique de mon enfance; c’est eux qui m’ont guidée vers l’âge adulte, et pourtant, je ne les perçois pas."
Isabelle Flükiger s’est révélée avec Du ciel au ventre (2003, éd. L’Age d’homme); elle a ensuite publié Se débattre encore (2004, éd. L’Age d’homme) et L’Espace vide du monstre (2007, éd. de l’Hèbe).
Ciel mes impôts
Les impôts, moins on en parle et mieux on se porte! Il suffit parfois d’entendre le mot pour être d’une humeur noire pour le restant de la journée. Acheter un ouvrage sur le sujet relève carrément du masochisme. Il est vrai qu’un livre scientifique bardé de références est réservé aux gens du métier, les initiés. Je n’avais pas l’envie, ni peut-être le talent pour le faire. Et pourquoi pas un petit recueil qui met en lumière les ratés de l’impôt, d’où qu’ils viennent?
Roland Devaud a travaillé de 1979 à 2016 pour le Service des contributions de l’État de Fribourg. Trente-sept années durant lesquelles il a compilé un dossier des pires (ou des plus belles) erreurs du fisc et de ses contribuables…
Ciel mes impôts - eBook
Les impôts, moins on en parle et mieux on se porte! Il suffit parfois d’entendre le mot pour être d’une humeur noire pour le restant de la journée. Acheter un ouvrage sur le sujet relève carrément du masochisme. Il est vrai qu’un livre scientifique bardé de références est réservé aux gens du métier, les initiés. Je n’avais pas l’envie, ni peut-être le talent pour le faire. Et pourquoi pas un petit recueil qui met en lumière les ratés de l’impôt, d’où qu’ils viennent?
Roland Devaud a travaillé de 1979 à 2016 pour le Service des contributions de l’État de Fribourg. Trente-sept années durant lesquelles il a compilé un dossier des pires (ou des plus belles) erreurs du fisc et de ses contribuables…
La Jeune Suisse
1248. Ils sont 1248, ces "Jeunes Suisses" dont Robert Giroud a retrouvé la trace et les noms dans les Archives de l’État du Valais, et qu’il nous livre aujourd’hui. Pourchassés et accusés par le gouvernement ultra-conservateur au temps du Sonderbund, qu’ont-ils encore à nous dire, ces militants très engagés qui n’hésitaient pas à prendre les armes et à risquer leur vie ? Robert Giroud, passionné par la mémoire de la mouvance politique libérale-radicale, retrace leur histoire au sein de cette courte mais intense période de 1830 à 1848 durant laquelle la Suisse en formation fut très attentive à la scène valaisanne, remplie de bruit et de fureur.
Robert Giroud (1941), originaire de Charrat, ancien vice-président de Collombey-Muraz, a consacré son master en histoire contemporaine au journal Le Confédéré dont il est un des chroniqueurs réguliers.
Préface de Bernard Comby, ancien conseiller d’État.
Images pour la presse
Gravure et photos (ZIP - 68Mo)
Revue de presse
Le Nouvelliste, mai 2017Méandres
Dans la droite ligne d’Une Rose et un balai de Michel Simonet, «Méandres» propose un beau portrait de la ville de Fribourg. La Basse-Ville et ses méandres sont au cœur de ces nouvelles. Les personnages qui donnent son atmosphère unique à la patrie des Bolzes illuminent ces nouvelles de leur présence. Boubi, Kiki, la moniale, le vieil homme assis sur un banc, le bâtisseur de pont, le cantonnier… autant de visages qui façonnent ces textes pleins de poésie.
A guichets fermés
Big Bad Boy est un voleur à la petite semaine. Il envisage pourtant le grand coup. Durant un match de hockey important de Fribourg-Gottéron, il souhaite profiter de la présence des supporters riches à la patinoire – les abonnées des places assises, dont il s’est procuré la liste – pour visiter leurs appartements. Il fait appel à Fredi Egger, qui n’est pas très futé. Ce dernier est aussi un grand fan de Gottéron: il a beaucoup de peine à manquer ce match important. A contrecœur, il fait pourtant la paire avec Big Bad Boy. Mais dès le premier appartement, les obstacles se dressent devant eux. Ils rencontrent un cadavre, qui n’est pas allé au match. A guichets fermés nous plonge dans le monde du hockey et du vol envisagé par des Pieds Nickelés.
Méandres - eBook
Dans la droite ligne d’Une Rose et un balai de Michel Simonet, «Méandres» propose un beau portrait de la ville de Fribourg. La Basse-Ville et ses méandres sont au cœur de ces nouvelles. Les personnages qui donnent son atmosphère unique à la patrie des Bolzes illuminent ces nouvelles de leur présence. Boubi, Kiki, la moniale, le vieil homme assis sur un banc, le bâtisseur de pont, le cantonnier… autant de visages qui façonnent ces textes pleins de poésie.
Ebullition, 25 ans
Pour ses 25 ans, Ebullition s’est mis en page dans ce livre événement. Il raconte Ebullition aux lecteurs qui ne le connaissent pas. Il évoque les souvenirs créés ensemble par tous ceux qui fréquentent le centre culturel bullois. Il dépeint le bel écrin de l’ancien Cinéma Lux, dans lequel sont maintenant proposées des découvertes artistiques axées sur les musiques actuelles. Il présente surtout un incroyable lieu de rencontres: parce qu’au-delà des événements qu’il organise, Ebullition rassemble un public hétérogène, dans lequel âges, cultures et milieux socio-économiques s’entremêlent pour mieux se comprendre.
Le livre aborde les prémisses de ce qui allait devenir le centre culturel Ebullition, avec un retour sur le contexte social de la fin des années quatre-vingt. Les présidents et les programmateurs successifs témoignent de leurs mémorables souvenirs, galères et défis. Les différents domaines qui font un centre culturel sont également décrits, notamment les loges, ce lieu mystérieux où les artistes sont accueillis, le bar, précieux espace de rencontres improbables, la technique, élément essentiel pour que vivent les concerts.
Des photographies, des affiches et des archives illustrent les propos et reviennent sur des instants mémorables qui ont contribué à faire d’Ebullition ce qu’il est devenu : un "petit" centre culturel fribourgeois qui, par la qualité de la programmation qu’il propose et l’ambiance chaleureuse qui l’habite, atteint la renommée des "grands".
Les carottes ne suffisent pas
Les carottes ne suffisent pas a changé la vie de beaucoup d’hommes et de femmes. Lecteurs, consommateurs ou paysans y ont puisé inspiration et vitalité pour se tourner résolument vers une production et une consommation plus responsables. Les témoignages sont éloquents : "Ce livre a été une révélation", "je croyais savoir, j’ai encore appris beaucoup de choses", "j’ai adoré ce livre, écrit comme une histoire que l’on raconte, le soir, à nos enfants", "je l’ai dévoré comme un roman."
Dans cet ouvrage, Josiane Haas et Martine Wolhauser relatent leur plongée de plus d’un an dans le quotidien de la ferme maraîchère d’Urs Gfeller. Installé à Sédeilles (VD), celui-ci a choisi le bio, la diversité et la vente directe. Sur six hectares, il fait vivre une vingtaine de collaborateurs. Ce sont les vrais héros de ce livre. Enrichi d’intersaisons sur des thèmes d’actualité (bio, vente directe et voies nouvelles), ce livre résume aussi avec justesse les défis qui se présentent aujourd’hui à notre agriculture et à notre alimentation.
Les carottes ne suffisent pas: un livre vrai et frais.
Trois jours de passion en Valais
Du 19 au 21 juillet 2009, le Valais a vécu à l'heure du Tour de France. Les spectateurs ont assisté au triomphe d'Alberto Contador dans l'étape de Verbier et c'est avec le maillot jaune qu l'Espagnol est reparti de Martigny, avant de gagner le Tour sur les Champs-Elysées.
Tous n'ont pas eu le même succès que Contador, à l'image du Néerlandais Kenny van Hummel qui a roulé près de 200km devant la voiture-balai pour parvenir à Verbier.
Revivez ces trois jours de passion au travers de 160 pages richement illustrée et agrémentée de nombreuses anecdotes au sujet du Tour et de son passage en Valais.
Bienvenue à Thanatos
Le troisième volet des enquêtes de Gary Abbott emmène le détective sur l’île de Thanatos. Mais ces vacances, infernales et tragiques ne vont pas lui changer les idées. Depuis le début de l’année, la mort rôde en effet sur le chemin de Gary et de ses amis. Difficile de n’y voir que des accidents, car comme le dit Bruno le hippie, le hasard n’existe pas.
"Quand trois jours plus tard, Tintin rejoint ses amis à Tanathos, il fut frappé par leur mine déconfite. Pour être précis, il fut d’abord frappé tout court. On avait oublié ses petits soucis de santé, on avait omis de lui demander s’il allait mieux et on avait passé sur les questions d’usage au sujet de la qualité de son voyage. On lui mit une baffe ou deux, et on lui demanda des explications."
Grandir en s’épanouissant
Un guide pratique pour les parents et les enseignants
Dans la préface que Matthieu Ricard a généreusement écrite pour l’ouvrage de Fabrice Dini, le porte-parole du Dalaï-Lama affirme tout son intérêt pour l’éducation intégrale, qui est au coeur de ce livre « Il est grand temps, écrit-il, que ces notions soient intégrées au monde de l’éducation et soient considérées comme des composantes indispensables de l’enseignement. » L’auteur du livre et son préfacier sont sur la même longueur d’onde : enfants et adultes ont en eux un potentiel formidable qui est, dans la plupart des cas, sous exploité.
Pour accompagner les enfants dans ce siècle plein d’opportunités et de complexité, il est temps de tenir compte de façon cohérente et subtile de l’ensemble des facteurs qui influencent leur développement physique, émotionnel, cognitif, social et intérieur ! Ce livre présente une vision intégrale, globale et pratique de l’éducation : des techniques pour développer les facultés mentales – mémorisation, concentration, visualisation – aux outils pour mieux gérer le stress et pour cultiver la confiance en soi chez les enfants et les adolescents. Il présente également les courants qui façonnent le futur de l’éducation : la pleine conscience, l’intelligence émotionnelle, la psychologie positive, la pédagogie par la nature, l’éthique et les qualités humaines fondamentales dans l’éducation, etc. Ce sont autant d’outils à explorer pour les parents et les enseignants. Il n’est pas besoin de lire cet ouvrage de bout en bout pour en tirer profit. On peut se saisir ci et là d’une bonne idée en le feuilletant, car son originalité tient dans la multitude d’exercices proposés. Ils peuvent être pratiqués à domicile ou à l’école et offrent des outils immédiatement applicables pour l’épanouissement équilibré des enfants.
Ce livre est un compagnon idéal si vous êtes enseignant. Il propose de nombreuses techniques inspirées de ce qui se fait de mieux dans les écoles et universités à travers le monde. Si vous êtes parent, vous découvrirez de nouvelles façons d’aborder votre rôle et vous pourrez explorer des outils qui seront pour vous et votre famille sources de joie et de profonde satisfaction.
De Courtepin au Cap Nord
Pour marquer ses 60 ans, Jean-Marie Zosso a couru son premier marathon, en novembre 2014, à New York. Dans la foulée, il a enchaîné avec un grand voyage à vélo jusqu’au Cap Nord. Suite à la maladie de l’une de ses filles, atteinte d’un mélanome métastasé, il a décidé de donner à ce voyage un caractère humanitaire en soutenant la Fondation Fond’Action contre le cancer.
"Le 29 mai 2015, je mettais le cap… sur le Cap Nord, avec mon vélo, dans le but de parcourir 60 x 60 kilomètres, soit la distance qui sépare mon village de Courtepin du Cap Nord, en Norvège. Sur mon site internet « Cap Nord Cap Vie », chacun pouvait symboliquement sponsoriser mes kilomètres de parcours. Le 11 août 2015, après 3 886 km à la force des mollets, mon rêve devenait réalité, puisque je touchais le fameux globe terrestre symbolisant la fin de la route la plus septentrionale d’Europe. Mon objectif de départ était atteint avec l’immense satisfaction d’avoir pu soulever un élan de générosité dans mon entourage, bien au-delà de mes espérances.
Porté par cette solidarité et désireux de ne pas m’arrêter en si bon chemin, j’ai décidé de donner un prolongement à mon action sous la forme d’un livre qui rassemble mes récits de voyage et mes photos, dans le but de toucher un plus large public."
Les bénéfices de ce livre seront versés à la fondation Fond’Action contre le cancer.
Les Schnetzes
L’artiste plasticienne Marie Vieli a l’habitude de raconter des histoires à ses neveux. De cette habitude et du plaisir qu’elle éprouve à raconter des histoires, elle a décidé d’écrire une histoire pour enfant, qu’elle illustre évidemment.
Ses Schnetzes sont d’infiniment petits bonhommes verts qui, sans le vouloir, crée le trouble au coeur de la ville: le concierge, les enfants, la boualngère, le policier et le pharmacien sont en émoi. Est-ce qu’une nouvelle maladie frappe la ville?
Trop tard pour mourir
Partir au bout du monde, pour se perdre une bonne fois pour toutes, pour ne plus jamais y penser, c’était l’idée! Seulement, ce voyage qui devait être un nouveau départ tourne au cauchemar quand une porte se referme sur des souvenirs qu’il eût été préférable de ne jamais avoir à consommer. Emprisonné dans un container, au milieu de son "chez soi", avec seulement la rage pour survivre, prêt à tout pour en sortir, c’est le temps des regrets qui commence… et qui ne finira peut-être jamais.
Yves Gaudin publie un premier roman intrigant et très abouti. Né en Valais, musicien professionnel, psychologue et musicothérapeute diplômé, l’homme a plus d’une corde à son arc.
Planches à Ressasser
Située quelque part entre les univers de Geluck et de Moebius, Planches à ressasser est une bande dessinée à l’humour absurde ravageur. Au menu, neuf petites histoires aux chutes improbables, fourmillant de trouvailles visuelles. Héros récurrent de trois d’entre elles, l’inspecteur Goumier mène des enquêtes qui l’entraîneront sur la lune et dans les nuages. Planches à ressasser est une œuvre pleine de couleurs et de gags qui provoque des crises de rire. Un livre de Marc Boivin (textes) et Olivier Zappelli (dessins).
Caractéristiques
Format: 21x29.7cm
Pages: 68
Une rose et un balai
Ce livre est malheureusement en rupture de stock. Vous pouvez toujours vous procurer la version électronique (eBook), ainsi que la version spéciale. Il existe également une version Pocket disponible en ligne.
La couleur orange est aveuglante. Personne ne distingue l’homme dans sa tenue de travail, dont l’éclat fait aussitôt barrière : circulez, rien à voir, juste un balayeur. Celui-ci fait exception, la rose fraîche attachée à son chariot d’ordures le rend visible et le fait remarquer. Le truc est bien connu, les chefs d’Etat aussi ont un fanion à leur voiture, il demeure efficace. On cherche à voir qui se cache derrière les vitres teintées ou sous la tenue orange. Avec Michel Simonet, on n’est pas déçu.
Cet homme porte sur lui la joie qui l’habite. Non pas l’hilarité bruyante du rigolo, mais un bonheur paisible que le regard atteste et que vient nuancer une pointe d’ironie – les lunettes à monture orange assortie au costume de travail, par exemple. Une joie profonde et discrète, celle de l’âme et de l’esprit, celle du croyant et du lettré. Pour l’âme, il s’en explique sans forfanterie ni fausse pudeur : «chrétien à l’air libre», avec «la foi du cantonnier», suivant le Christ en souliers à coque renforcée. Pour la gamberge littéraire, il l’assaisonne de clins d’œil potaches, signant «Joachin du Balai» ou pastichant Prévert : «Je vous salis ma rue…» Notre balayeur n’a rien de pédant, mais il est conscient de son capital culturel. Formé au collège Saint-Michel, pour tout dire, sur un modèle classique à l’épreuve du temps. Humaniste, on peut le dire aussi.
Cela se voit bien dans son rapport au travail, intellectuel ou manuel. Je me plais à situer Michel Simonet dans la ligne du formidable savant bâlois de la Renaissance, Thomas Platter, homme de plein air et infatigable marcheur lui aussi, frotté lui aussi de latin, de grec et d’hébreu, qui n’était pas capable seulement d’écrire un livre, mais encore de l’imprimer et de le relier de ses mains. Il n’y a pas, aux yeux de ces gens-là, d’ouvrage noble et d’ouvrage trivial, seulement du travail bien fait ou bâclé. Il n’y a pas non plus de travail facile. Les outils du balayeur sont lourds, ses horaires pénibles, et l’humeur du ciel souvent difficile à supporter. Lui voit le bon côté des choses : passer sa vie en plein air, tenir une belle forme athlétique, et jouir dans son emploi du temps d’appréciables marges de liberté. Humanisme, optimisme, cela va de pair : cherchez le bon côté des hommes et des choses, enseignaient les Anciens, il en existe toujours un.
Et quelle joie de le découvrir, ou de le retrouver ! Notre balayeur me fait penser à l’ouvrier des trams dont Italo Calvino a fait le héros d’un livre de contes : Marcovaldo enchante sa banlieue milanaise comme jadis Merlin la forêt de Brocéliande. Tous deux pourvus d’une famille nombreuse et d’une humble occupation, Marcovaldo et Simonet dénichent en toute saison des merveilles au fil des rues, au rebord des trottoirs, au pied des réverbères… Pauvres touristes, qui arpentez nez en l’air les centres historiques, vous ne connaîtrez jamais que tours de cathédrales et frontons de palais ! Les vrais connaisseurs marchent les yeux au sol, ils regardent à la bonne hauteur. Ils savent que le tissu urbain n’est pas architectural d’abord, mais social, et que sa trame est faite d’indices à interpréter : un mégot, une canette, un préservatif, une fleur séchée, une mitaine d’enfant… Au bout de la piste, un peuple entier, avec mille histoires d’amour, de solitude ou d’amitié. Et comme toujours, la quête est plus belle encore que le but.
Michel Simonet a donc fait ce livre foutraque et plein de santé, qui ne ressemble à rien, sauf à ce dont il traite : un homme, son métier, sa ville.
Jean Steinauer
Une rose et un balai (édition spéciale)
Pour fêter le succès du livre de Michel Simonet, les éditions Faim de Siècle ont le plaisir de vous présenter l'édition spéciale (édition limitée à 200 exemplaires numérotés, grand format 15x29cm).
La couleur orange est aveuglante. Personne ne distingue l’homme dans sa tenue de travail, dont l’éclat fait aussitôt barrière : circulez, rien à voir, juste un balayeur. Celui-ci fait exception, la rose fraîche attachée à son chariot d’ordures le rend visible et le fait remarquer. Le truc est bien connu, les chefs d’Etat aussi ont un fanion à leur voiture, il demeure efficace. On cherche à voir qui se cache derrière les vitres teintées ou sous la tenue orange. Avec Michel Simonet, on n’est pas déçu.
Cet homme porte sur lui la joie qui l’habite. Non pas l’hilarité bruyante du rigolo, mais un bonheur paisible que le regard atteste et que vient nuancer une pointe d’ironie – les lunettes à monture orange assortie au costume de travail, par exemple. Une joie profonde et discrète, celle de l’âme et de l’esprit, celle du croyant et du lettré. Pour l’âme, il s’en explique sans forfanterie ni fausse pudeur : «chrétien à l’air libre», avec «la foi du cantonnier», suivant le Christ en souliers à coque renforcée. Pour la gamberge littéraire, il l’assaisonne de clins d’œil potaches, signant «Joachin du Balai» ou pastichant Prévert : «Je vous salis ma rue…» Notre balayeur n’a rien de pédant, mais il est conscient de son capital culturel. Formé au collège Saint-Michel, pour tout dire, sur un modèle classique à l’épreuve du temps. Humaniste, on peut le dire aussi.
Cela se voit bien dans son rapport au travail, intellectuel ou manuel. Je me plais à situer Michel Simonet dans la ligne du formidable savant bâlois de la Renaissance, Thomas Platter, homme de plein air et infatigable marcheur lui aussi, frotté lui aussi de latin, de grec et d’hébreu, qui n’était pas capable seulement d’écrire un livre, mais encore de l’imprimer et de le relier de ses mains. Il n’y a pas, aux yeux de ces gens-là, d’ouvrage noble et d’ouvrage trivial, seulement du travail bien fait ou bâclé. Il n’y a pas non plus de travail facile. Les outils du balayeur sont lourds, ses horaires pénibles, et l’humeur du ciel souvent difficile à supporter. Lui voit le bon côté des choses : passer sa vie en plein air, tenir une belle forme athlétique, et jouir dans son emploi du temps d’appréciables marges de liberté. Humanisme, optimisme, cela va de pair : cherchez le bon côté des hommes et des choses, enseignaient les Anciens, il en existe toujours un.
Et quelle joie de le découvrir, ou de le retrouver ! Notre balayeur me fait penser à l’ouvrier des trams dont Italo Calvino a fait le héros d’un livre de contes : Marcovaldo enchante sa banlieue milanaise comme jadis Merlin la forêt de Brocéliande. Tous deux pourvus d’une famille nombreuse et d’une humble occupation, Marcovaldo et Simonet dénichent en toute saison des merveilles au fil des rues, au rebord des trottoirs, au pied des réverbères… Pauvres touristes, qui arpentez nez en l’air les centres historiques, vous ne connaîtrez jamais que tours de cathédrales et frontons de palais ! Les vrais connaisseurs marchent les yeux au sol, ils regardent à la bonne hauteur. Ils savent que le tissu urbain n’est pas architectural d’abord, mais social, et que sa trame est faite d’indices à interpréter : un mégot, une canette, un préservatif, une fleur séchée, une mitaine d’enfant… Au bout de la piste, un peuple entier, avec mille histoires d’amour, de solitude ou d’amitié. Et comme toujours, la quête est plus belle encore que le but.
Michel Simonet a donc fait ce livre foutraque et plein de santé, qui ne ressemble à rien, sauf à ce dont il traite : un homme, son métier, sa ville.
Jean Steinauer
Une rose et un balai - eBook
La couleur orange est aveuglante. Personne ne distingue l’homme dans sa tenue de travail, dont l’éclat fait aussitôt barrière : circulez, rien à voir, juste un balayeur. Celui-ci fait exception, la rose fraîche attachée à son chariot d’ordures le rend visible et le fait remarquer. Le truc est bien connu, les chefs d’Etat aussi ont un fanion à leur voiture, il demeure efficace. On cherche à voir qui se cache derrière les vitres teintées ou sous la tenue orange. Avec Michel Simonet, on n’est pas déçu.
Cet homme porte sur lui la joie qui l’habite. Non pas l’hilarité bruyante du rigolo, mais un bonheur paisible que le regard atteste et que vient nuancer une pointe d’ironie – les lunettes à monture orange assortie au costume de travail, par exemple. Une joie profonde et discrète, celle de l’âme et de l’esprit, celle du croyant et du lettré. Pour l’âme, il s’en explique sans forfanterie ni fausse pudeur : «chrétien à l’air libre», avec «la foi du cantonnier», suivant le Christ en souliers à coque renforcée. Pour la gamberge littéraire, il l’assaisonne de clins d’œil potaches, signant «Joachin du Balai» ou pastichant Prévert : «Je vous salis ma rue…» Notre balayeur n’a rien de pédant, mais il est conscient de son capital culturel. Formé au collège Saint-Michel, pour tout dire, sur un modèle classique à l’épreuve du temps. Humaniste, on peut le dire aussi.
Cela se voit bien dans son rapport au travail, intellectuel ou manuel. Je me plais à situer Michel Simonet dans la ligne du formidable savant bâlois de la Renaissance, Thomas Platter, homme de plein air et infatigable marcheur lui aussi, frotté lui aussi de latin, de grec et d’hébreu, qui n’était pas capable seulement d’écrire un livre, mais encore de l’imprimer et de le relier de ses mains. Il n’y a pas, aux yeux de ces gens-là, d’ouvrage noble et d’ouvrage trivial, seulement du travail bien fait ou bâclé. Il n’y a pas non plus de travail facile. Les outils du balayeur sont lourds, ses horaires pénibles, et l’humeur du ciel souvent difficile à supporter. Lui voit le bon côté des choses : passer sa vie en plein air, tenir une belle forme athlétique, et jouir dans son emploi du temps d’appréciables marges de liberté. Humanisme, optimisme, cela va de pair : cherchez le bon côté des hommes et des choses, enseignaient les Anciens, il en existe toujours un.
Et quelle joie de le découvrir, ou de le retrouver ! Notre balayeur me fait penser à l’ouvrier des trams dont Italo Calvino a fait le héros d’un livre de contes : Marcovaldo enchante sa banlieue milanaise comme jadis Merlin la forêt de Brocéliande. Tous deux pourvus d’une famille nombreuse et d’une humble occupation, Marcovaldo et Simonet dénichent en toute saison des merveilles au fil des rues, au rebord des trottoirs, au pied des réverbères… Pauvres touristes, qui arpentez nez en l’air les centres historiques, vous ne connaîtrez jamais que tours de cathédrales et frontons de palais ! Les vrais connaisseurs marchent les yeux au sol, ils regardent à la bonne hauteur. Ils savent que le tissu urbain n’est pas architectural d’abord, mais social, et que sa trame est faite d’indices à interpréter : un mégot, une canette, un préservatif, une fleur séchée, une mitaine d’enfant… Au bout de la piste, un peuple entier, avec mille histoires d’amour, de solitude ou d’amitié. Et comme toujours, la quête est plus belle encore que le but.
Michel Simonet a donc fait ce livre foutraque et plein de santé, qui ne ressemble à rien, sauf à ce dont il traite : un homme, son métier, sa ville.
Jean Steinauer
Visages des Soupes
Depuis neuf ans, chaque hiver, le Festival de Soupes s’installe au cœur de Fribourg. Cette année, pour la 10e édition, les organisateurs – le centre d’accueil d’urgence La Tuile – font paraître un livre aux Editions Faim de Siècle.
Durant cette quinzaine, tout Fribourg se côtoie "aux soupes" pour donner et recevoir de la chaleur. Les personnes en difficulté rencontrent les hommes politiques, les jeunes passent un moment avec les retraités, les familles viennent partager une soupe…
Ce livre retrace cette aventure exceptionnelle avec une profusion de témoignages et d’images. Il met des visages sur tous ceux qui s’engagent pour que ce moment soit, chaque année, inoubliable.
La Guérite
On va au musée et à l’opéra lorsqu’on ne baise plus ; sinon ce n’est pas la peine ! L’opéra, c’est un truc pour faire croire qu’il existe des plaisirs raffinés, des extases insoupçonnées. C’est fou les allures qu’on se donne pour faire passer le champagne quand le sexe ne fonctionne plus, cette manière de se pavaner, de jouer du torse alors que le meilleur de la vie est loin derrière ; parce qu’une cravate et un air autorisé ne vaudront jamais le regard d’une fille quand ce sont tes hanches qui la mettent en feu et qu’elle ne se demande même pas si tu es banquier ou si tu pointes au chômage.
Le dixième roman de Michaël Perruchoud est un coup de poing donné avec le sourire . Tendre et agressif, doux et caustique, il attaque là où ça fait mal et caresse là où ça fait du bien.
Queue de listes & amusants petits quiz
Marc Boivin (Les Dicodeurs) achève son Cycle des listes (Liste de listes, Suite de listes. Il propose également quelques-uns de ces Amusants petits quiz dont il régale les auditeurs. Paru en 2014.
Langage des fleurs
Rose rouge: je t’aime.
Rose rouge en plastique: je t’aime. As-tu des préservatifs?
Pâquerette: je t’aime, mais je n’ai pas beaucoup d’argent à dépenser pour toi.
Nénuphar: je t’aime, mais tu prends un peu trop de place.
Lavande: je t’aime, mais je n’ai plus de slips propres. Peux-tu me faire une lessive?
Queue de listes & amusants petits quiz - eBook
Marc Boivin (Les Dicodeurs) achève son Cycle des listes (Liste de listes, Suite de listes. Il propose également quelques-uns de ces Amusants petits quiz dont il régale les auditeurs. Paru en 2014.
Langage des fleurs
Rose rouge: je t’aime.
Rose rouge en plastique: je t’aime. As-tu des préservatifs?
Pâquerette: je t’aime, mais je n’ai pas beaucoup d’argent à dépenser pour toi.
Nénuphar: je t’aime, mais tu prends un peu trop de place.
Lavande: je t’aime, mais je n’ai plus de slips propres. Peux-tu me faire une lessive?
Riff sanglant à Fri-Son
Un meurtre peu banal est perpétré dans les loges de Fri-Son. Le leader d’un groupe de death metal est retrouvé mort, décapité, à dix minutes de son entrée sur scène. C’est une vision d’horreur, même pour des gens qui jouent avec l’image du Mal.
Le deuxième polar de Cédric Clément met en scène Gary Abbot, un personnage absurde, à mi-chemin entre Hercule Poirot et Jean-Baptiste Adamsberg. Le loufoque n’est jamais très loin.
Riff sanglant à Fri-Son - eBook
Un meurtre peu banal est perpétré dans les loges de Fri-Son. Le leader d’un groupe de death metal est retrouvé mort, décapité, à dix minutes de son entrée sur scène. C’est une vision d’horreur, même pour des gens qui jouent avec l’image du Mal.
Le deuxième polar de Cédric Clément met en scène Gary Abbot, un personnage absurde, à mi-chemin entre Hercule Poirot et Jean-Baptiste Adamsberg. Le loufoque n’est jamais très loin.
Le journal de Marie-Anne
Je m’appelle Marie-Anne, en deux mots, attention, Marie-Anne!
Je suis une jeune fille – est-ce utile de le préciser? – de 30 ans – je préférerais ne pas avoir à le préciser – célibataire – no comment.
Je travaille comme caissière dans un grand magasin et je raconte depuis quelques années mes petites péripéties à la radio. Comme casser les oreilles des gens ne me suffisait plus, je sors à présent un recueil de mes chroniques.
Un livre de Sandrine Biermann, paru en 2013.
Entretiens avec Georges Haldas
Réalisés en collaboration avec les Editions Regards, les Entretiens avec Georges Haldas (4 CD) reviennent sur le parcours d’un homme qui a consacré sa vie à l’écriture. Un passionnant parcours à travers la littérature, la foi, le monde d’aujourd’hui et la ville qu’il aime entre toutes: Genève.
On peut lire Georges Haldas. On pourra désormais l’écouter. Au cours de quatre Entretiens avec Georges Haldas recueillis par Charly Veuthey et Simon Roth, l’écrivain s’exprime sur des thèmes qui lui tiennent à cœur: "Genève, ma ville", "De l’écriture aux Ecritures", "Déserts et Oasis", "Lectures essentielles". Un voyage à travers la mémoire, les questions fondamentales, les œuvres majeures de la littérature, la genèse d’une écriture et son mûrissement au contact de la Parole de Dieu, la société et ses interrogations. De sa voix chaleureuse et profonde, Georges Haldas raconte un itinéraire, partage des expériences fondatrices, explique sa pensée, s’exprime sur le monde d’aujourd’hui, et à travers lui c’est tout un siècle avec ses lumières et ses turbulences que l’on découvre.
L’itinéraire proposé par les Éditions Regard et les Éditions faim de siècle, éditeurs du coffret de quatre disques compacts, commence à Genève, la ville natale de Haldas. Il se poursuit par l’évocation de la trajectoire de l’écrivain, de ses débuts à sa rencontre féconde avec les Ecritures, dans ce qu’il appelle "l’Etat de Poésie". Puis Haldas livre son regard sur la société, un désert semé d’oasis qui sont autant de lieux de fraternité. Enfin, il évoque les auteurs qui l’ont nourri et les "livres de vie", ces "rendez-vous de réflexion" qui parlent des questions essentielles.
Genève, pour Haldas, est cette "rose des vents au cœur de l’Europe" qui conjugue concentration et ouverture sur le visible, cette "petite ville qui porte le monde". Haldas trouve de secrètes corres-pondances entre sa vie personnelle et cette cité "constamment en lien avec son au-delà et où je me sens très présent au monde".
Genève, ma ville
Genève, pour l’écrivain, c’est essentiel-lement la ville de son enfance, de son adolescence et de ses débuts littéraires, cette "ville intérieure qui échappe au temps et à l’espace et qui demeure en nous". C’est "tous les visages que j’ai vus et qui sont descendus en moi pour y former un humus humain". Genève c’est la Place Neuve, "respiration qui fait sentir son aura intime", la Place Saint-Gervais avec ses clochards, ses artisans et ses marchands, les quartiers des Pâquis et des Eaux-Vives avec leur vie diurne et leur vie nocturne, la halle aux poissons, les petits cafés, le marché et la fête populaire. C’est le murmure de l’Arve, les roulottes des romanichels, le cri des foulques, les carillons la nuit, le bruit des fontaines, le temps de mars et le ciel de septembre, tous "ces liens que j’ai tissé avec l’impondérable qui est l’essentiel".
Haldas évoque aussi Genève à travers les grandes figures qui l’ont marquée: Rousseau, Calvin, Léon Nicole et Georges Oltramare; et ses écrivains: Henri Amiel, Pierre Girard, Philippe Monnier, Charles-Albert Cingria. Pour constater enfin que "l’écriture est inférieure au vécu, elle n’en est que le témoin".
De l’écriture aux Ecritures
"De l’écriture aux Ecritures" raconte le cheminement d’un écrivain. Haldas y rappelle sa conception de l’écriture, "qui touche aux assises de l’être": elle est "nécessité de dire la vie dans son horreur et ses merveilles". Ecrire, pour lui, c’est "parler des choses de la vie avec les mots de tous les jours", héritage de son père grec et de sa mère genevoise. C’est être en "Etat de Poésie", à la fois disponibilité qui rend réceptif aux choses de la vie et sentiment que le visible cache l’invisible, cette "réalité fondatrice du visible où se trouve cette Source unique d’où nous procédons tous". Haldas parle de l’écriture comme d’une fulgurance et d’un "échec fertile" qui fait sentir la richesse de la vie.
Le poète est témoin et serviteur d’une parole, d’où le lien pour Haldas entre l’écriture et la Bible. Etat de Poésie et Ecritures s’éclairent mutuellement: tous deux demandent de vivre ce qui est dit et témoignent que "les grands mystères se révèlent à travers le quotidien". Dans cet entretien, Haldas évoque les figures bibliques qui l’attirent: Abraham, Job, Judas, le bon larron, les pèlerins d’Emmaüs, la Samaritaine, Marie de Magdala.
Déserts et Oasis
"Déserts et Oasis", c’est l’évocation des trois déserts qui marquent le monde moderne: le désert géographique, le désert social et le désert intime. Le désert géographique, le désert de sable, pour Haldas, c’est le risque de s’égarer, de perdre ses repères, de perdre la voie, donc la vie. Il est lieu de passage et d’oasis - la rencontre de personnes - et lieu des révélations fondamentales pour les trois monothéismes marquées par les figures de Moïse, de Jean Baptiste et du Christ, qui y signifie son refus de la puissance au profit de la relation aimante qui pousse à "donne sa vie pour que l’autre vivre".
Le désert social est dominé par la névrose de puissance, la course au profit dans une économie mondialisée qui écrase l’homme, le déboussolement général des consciences et la perte de sens. Trois symptômes le caractérisent: l’effacement du politique devant l’économie, l’étouffement de la liberté par les Eglises et leur incapacité à répondre aux questions des femmes et des hommes de ce temps, une science qui n’est pas en mesure de donner réponse aux questions essentielles de la destinée humaine. L’espoir demeure: celui de voir se constituer des oasis de fraternité tissées de solidarités à la base et de relations aimantes qui réaffirment le primat de la personne. Car "nous sommes tous les feuilles d’un même arbre, les enfants d’une même Source" et "réussir sa vie c’est être toujours plus homme, toujours plus relié à cette Source et à travers elle aux autres".
Lectures essentielles
Dans l’entretien intitulé "Lectures essentielles", Haldas évoque le rapport, dans sa trajectoire littéraire, entre la lecture et l’écriture: c’est "une relation organique constante". Des "livres de vie" ont jalonné son parcours: "L’Illiade", "L’Odyssée", "Don Quichotte", les œuvres de la littérature grecque, de la littérature russe, de la littérature espagnole, "qui témoignent de mentalités différentes qui nous font entrer dans de nouveaux modes de pensée", et les livres fondateurs des trois monothéismes: la Bible, le Coran. Des auteurs l’ont inspiré et continuent de nourrir son œuvre: Friedrich Nietzsche, Fedor Dostoïevski, Marcel Proust, Blaise Pascal, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé. Seuls comptent pour lui ces "livres de vie", car ils abordent les questions fondamentales de l’origine et de la destinée de l’homme, de la vie et de la mort. "Ils se font oublier pour permettre au lecteur de parcourir son chemin de vérité, trouve sa voie dans la fidélité à lui-même. (Geneviève Cornet)
L'école libre de Bagnes, 1900-1943
L'école libre de Bagnes exerça son activité dans la commune de Bagnes, plus précisément dans le village du Châble, puis de Villette, de 1900 à 1943. Elle présente l'originalité d'avoir renoncé à l'enseignement religieux, à un moment où celui-ci occupait une place capitale dans les programmes de l'enseignement primaire valaisan. Ce sujet d'histoire locale n'avait jamais été abordé auparavant, si ce n'est de manière très succincte: un foisonnement d'implications politiques et idéologiques sous-tendait cette expérience tant au niveau régional qu'international; la laïcité de l'enseignement est aujourd'hui encore un sujet d'actualité; ce travail est à inscrire dans un contexte plus général de l'histoire des idées en Valais au tournant du siècle, histoire encore peu écrite.
Rex Tremendae
"Elle tremblait. Je réalisais que je venais de faire quelque chose d’horrible, mais je m’en balançais. Je retirais même un malin plaisir à savoir que je venais de faire quelque chose d’horrible. Je ne disais rien mais j’avais le cœur chaud et souriant. Je me suis essuyé la bedaine avec la douillette et me suis levé. Je l’entendais tressaillir sur les draps. J’ai mis la main sur mes fringues et me suis glissé dedans. Je n’avais plus rien à foutre là. Je le savais. Je devais partir. J’enfilais mon chandail lorsqu’elle a éclaté. Presque aussitôt, j’ai senti quelque chose de dur me heurter la tête. Un disque, je crois. Puis un autre me frôler à ma gauche. Elle hurlait littéralement, un mélange de cris et de sanglots avalés."
Un roman de Sylvain Côté.
Voulez-vous être conseiller national
Edité en 1958, ce pamphlet politique porte les marques de son temps. Il a cependant étonnement peu vieilli. "Rien de nouveau sous le soleil, disions-nous l’autre jour, longtemps après l’Ecclésiaste", écrivait Léon Savary. Oui, les hommes se ressemblent passablement d’âge en âge. Et si, depuis quarante ans, beaucoup se plaignent de la lenteur des réformes dans notre pays, c’est sans doute que les hommespolitiques d’aujourd’hui ne sont pas très différents de leurs pères. Aussi ce livre demeure-t-il, à mon sens, de bon conseil pour qui voudrait accéder à la chambre du peuple.
Si vous voulez devenir conseiller national, commencez naturellement par faire allégeance à un parti politique. Evitez seulement "les extrêmes, qui dans notre pays, sont d’un mauvais rendement électoral." Vous faites "un peu peuple" comme Jean-Louis Trublet, le héros tragi-comique de cet ouvrage? Alors n’espérez pas adhérer au parti libéral. Sous ces réserves, vous avez le choix. Tissez lentement votre toile, montrez votre attachement à votre canton, graissez la patte des sociétés locales, ne refusez jamais un "dîner-choucroute" ou un "souper-tripes". Le jour de l’élection, faites tracer les noms de vos colistiers sans manquer de déplorer le procédé et, sûr de votre victoire, assénez enfin l’argument massue: "Le peuple a parlé."
Vous voilà donc à Berne. Là, multipliez les contacts personnels et mettez-vous d’emblée à l’étude du jargon parlementaire. Désormais ne dites plus: "une belle vache; dites: une pièce sélectionnée de notre cheptel bovin; ne dites pas: un chat qui attrape bien les souris; dites: un félidé domestique, spécialement apte à l’extermination des rongeurs de l’espèce micromyominutus; ne dites pas: une maison; dites: un immeuble affecté à l’habitation…" Ne manquez pas non plus de profiter de votre situation pour faire, avec mesure naturellement, un peu de racket. Faites effet dans les commissions en prononçant quelques chiffres savants, monnayez votre pouvoir d’électeur du Conseil fédéral et, de grâce, ne vous privez pas, durant une pause bien méritée au café du coin, de pincer le postérieur d’une gentille sommelière et de vous exclamer : "Elle a de belles fesses, n’est-ce pas? Ah! ah! ah! Elle a de belles fesses!" Vous laisserez, semble-t-il, le souvenir d’un homme d’infiniment d’esprit.
Voilà pour les conseils, voilà pour le fond. Ajoutons que l’on trouvera rarement, dans cet ouvrage, cette formidable violence et cette aigreur qui émane parfois des écrits pamphlétaires de nos voisins français, ou même de certains de nos compatriotes fortement engagés. Voulez-vous être conseiller national n’est pas tant le livre de la dénonciation. C’est le livre de la dérision, et peut-être de l’autodérision. Et ce n’est pas là sa moindre qualité. Si nul ne les ménage, force est de constater que l’on peine, dans ce pays, à se moquer des politiciens. Qu’un chroniqueur s’essaie un jour à un peu d’humour dans le domaine et il se fait prestement virer. Pourtant, savoir rire de ses élus c’est aussi montrer que l’on sait rire de soi. Et savoir rire de soi, comme savoir parfois fermer les yeux, c’est tout l’art de vivre.
Né dans le canton de Neuchâtel de père vaudois, un pasteur, et de mère balte, Léon Savary se convertit au catholicisme et séjourna de nombreuses années à Fribourg. Avant de vivre à Genève, Berne et Paris. Erudit, il fut un grand connaisseur de l’Eglise. Dans le dossier qui suit cette réédition, le théologien Jean-Marie Savioz se penche sur L’enfant terrible de l’Eglise, sur le troublant parcours religieux de cet homme complexe. (ngb)
Livre illustré par des dessins de Mix et Remix.
Portrait d'atelier
Les ateliers d’artistes sont des endroits magiques. S’ils ont chacun leursparticularités, ils forcent tous le respect.
Dire qu’ils sont le reflet de la personnalité du maître des lieux est un peu osé. Ils restent néanmoins des espaces où l’on entre avec piété, car il s’y passe quelque chose de spécial.
Nous avons décidé de franchir leur porte pour réaliser ce livre. Jean-Luc Corpataux, Pierre Loye, Pierre-Alain Morel, Jean-Jacques Putallaz et Nicolas Wuersdoerfer nous ont accueillis. Chacun à sa manière. Portrait d’atelier est le résultat de ces rencontres. Un livre loin des ouvrages académiques et des traités sur l’art: une approche intime de l’homme à son travail.
Le désir de publier un livre sur l’art était en nous depuis longtemps. Profitant de l’ouverture de la galerie de la Schürra, nous avons décidé de partir à la rencontre des artistes. A la différence des ouvrages traditionnels qui suivent le schéma critique-oeuvre, nous avons voulu privilégier les rapports humains. Les artistes ont répondu favorablement à notre demande. Nous nous sommes rendus dans leurs ateliers. Lors d’une première visite servant à nous apprivoiser mutuellement, nous avons établi ensemble un canevas pour notre discussion. Munis d’un magnétophone, nous sommes ensuite retournés voir les artistes. L’étape suivante a consisté à retranscrire les interviews pour réaliser un texte de base. C’est ce texte que nous avons envoyé aux artistes. Chacun y a apporté sa touche, suivant ses désirs et sa personnalité. Certains ont carrément réécrit le texte; d’autres n’ont corrigé que de petits passages; d’autres encore ont eu envie d’approfondir ce qu’ils avaient, à leur goût, trop négligé; d’autres enfin se sont complètement retirés et nous ont laissé carte blanche. Le résultat est étonnant. Partant tous du même canevas, les textes aboutissent à des versions variées, proches des sensibilités de leurs auteurs. Riche en surprises, l’expérience à laquelle les artistes se sont prêtés n’a certes pas été facile. Ayant l’habitude de s’exprimer par des moyens graphiques, le passage à l’écrit comporte des risques, comme celui de trop se dévoiler ou de ne pas parvenir à exprimer l’exacte pensée qui les anime. Il recèle aussi des avantages: une occasion rare d’apporter soi-même des précisions sur le travail artistique fourni. Nous tenons donc à remercier ici les artistes pour leur accueil chaleureux et le temps qu’ils nous ont consacré. En pénétrant dans leur travail, par le regard ou le dialogue, nous avons découvert des êtres ancrés dans des problématiques variées mais forts d’une énorme générosité et d’une vraie intelligence. (jrw/sl)
Un livre de Sophie Lugon et Jean-Rodolphe Wuersdorfer.
Non-lieu
C'est un soir d'hiver: Julius conduit son tram, dans une ville qui pourrait être Genève. Et l'accident survient. Est-il responsable? C'est loin d'être sûr. Mais autour de lui la question devient vite rumeur, le doute s'insinue dans les esprits. A première vue pourtant, on ne peut pas reprocher grand-chose à Julius. Mais un enfant est mort. Il faut une réponse.
Animaux sauvages et chasseurs du Valais: Huit siècles d'histoire (XIIe-XIXe)
La vie quotidienne à Sion au milieu du XIXe siècle
Avec La vie quotidienne à Sion au milieu du XIXe siècle. Le témoignage d’un règlement de police, agrémenté d’un iconographie inédite, l’archiviste Patrice Tschopp fait revivre un document savoureux qui met en scène les us et coutumes à la fois si proches et si lointains.
L'or et le sable
"Tenir journal quand on n’a point de loisir, pourquoi? On note à la hâte, et quand on peut, unincident mineur, une rencontre sans importance, la première idée venue saisie par cette plume instantanée dont la loi est d’engluer dans son fil sans reprise la proie présente… Et l’idée facile d’un moment, pour être fixée se dilate, vaticine, fait l’importante, alors que d’autres réflexions plus sérieuses mais plus ardues s’évanouissent dans l’oubli. Voilà le détail, le fait banal divulgué, quand l’essentiel est tu. Quelle vérité un lecteur de l’avenir va-t-il trouver dans ce désordre sans équité ni proportion? Eh bien, faute de loisir pour me déchiffrer intimement, et pour réfléchir avec un peu de suite et de pertinence sur l’homme et sur l’univers, ce désordre me rassure cependant parce qu’un peu d’or s’y mêle au sable."
Antoine Dousse, Juillet 1970
Extrait, 25 janvier 1946
Fribourg, le 25 janvier, minuit
Conférence de François Mauriac à l'Aula de l'Université. En fait, c'est une conférence de notre René Bady, admirable d'ailleurs, sur Mauriac et qui dure plus d'une heure. Mauriac, ainsi préfacé, ne parle que vingt ou trente minutes, pathétiquement, avec sa voix brisée, de ce que la France vient de vivre. Je ne le résume pas, car cela sera sans doute publié… Je veux, bien sûr, approcher Mauriac, mais comment faire? Je cours à l'Hôtel suisse, où une réception doit suivre la conférence. Comme je n'y suis pas convié (je ne fais pas partie de la société Sarinia, qui a monté Asmodée et invité Mauriac, ni d'ailleurs d'aucune autre confrérie académique, j'en ai horreur), j'essaie d'obtenir la couverture du professeur Serge Barraud que je vois attendre dans le hall, sec et immobile comme un héron, et plus chauve que jamais ; mais il m'écarte, effrayé, en grommelant qu'il n'est pas invité non plus… Je sors au moment où se range, au bord du trottoir, une grande voiture noire d'où descend Bady qui ouvre la portière à Mauriac. Il m'aperçoit, me saisit le bras, me pousse au-devant du grand homme: "Permettez que je vous présente Antoine Dousse, un de mes étudiants qui est un admirateur fervent de votre œuvre." Ensemble ils m'entraînent au premier étage où est servi un souper. Mauriac est charmant et drôle, il me félicite d'abord d'avoir la chance d'étudier à Fribourg et sous la conduite de Bady. "Vous avez une magnifique université. Chez nous, dans nos facultés, tout est vétuste et insuffisant, et la plupart des étudiants vivent très difficilement. C'est que, vous comprenez, la reconstruction a d'autres priorités, les villes détruites, les hôpitaux démunis, notre réseau ferroviaire disloqué… La situation est désastreuse sur tous les plans à la fois. Vous, en Suisse, vous êtes en sécurité. Dans une forteresse. Alors que nous Français nous luttons sur le champ de bataille. On tire encore de tous les côtés… Pan! pan! pan!" Et il fait mine de tirailler en éclatant de rire… Il nous parle du débat politique, de la haine jalouse des vieux ténors à l'égard de De Gaulle: "Il les gêne, car eux voudraient reprendre leurs intrigues et leur jeu d'antan comme si la guerre, l'occupation, la résistance, la victoire n'avaient été qu'une parenthèse, désormais refermée. Lui, c'est le Commandeur, dont la stature simplement les épouvante, ils feront tout pour l'abattre… Certes, il est très fort, il a rendu à la France la république et la dignité, mais il ne veut pas d'une république des rats, - ce n'est pas pour elle qu'il a entraîné au sacrifice et au combat tant de Français. Si répugnants que soient les rats, il ne faut pas sous-estimer leur pouvoir de nuire, - ils ont toujours véhiculé la peste." Je reconnais les métaphores animales, qui ont la concision du mépris. Tout attention, je scrute le visage décharné mais extraordinairement mobile et expressif, les yeux vifs, la bouche carnassière qui corrige par une nette articulation ce que la voix a de brisé. Et les longues mains maigres qui soulignent les phrases et soudain se joignent immobiles. Bady l'oriente sur son œuvre et l'interroge sur l'origine et la genèse de ses romans. Confidences intéressantes. "J'ai peint mon milieu, c'est-à-dire la bourgeoisie catholique, possédante et conservatrice que mon enfance et ma jeunesse observaient avec une attention d'autant plus aiguë qu'elle était silencieuse à Bordeaux et dans les Landes où nous passions nos vacances. Pays de grandes passions, mais passions muettes, étouffées par le conformisme et l'hypocrisie d'une société dont on ne peut concevoir aujourd'hui quels préjugés l'aveuglaient ni quelles haines elle couvait. J'ai vécu l'affaire Dreyfus du côté catholique ; par sa presse (La Croix avait alors une immense influence) et la parole même de sa hiérarchie, l'Eglise se déchaînait contre les Juifs. Oui, nous avons, chrétiens, une grande responsabilité dans ce qui est arrivé… J'étais encore trop jeune, cependant j'observais, parmi ces bourgeois bien nantis et bien pensants, les amours, les inimitiés, les envies et les drames qui consument les êtres en secret. Cela a nourri mes romans, certes, mais sans que je le voulusse vraiment. Mon climat est un peu celui des tragédies de Racine, oui. Des critiques ont découvert quelque parenté entre ma Thérèse et Phèdre, - c'est flatteur, et je me garde de les contredire!... (Rire) Mais enfin, j'aurais préféré faire tout autre chose, qui aurait eu la pureté et la grâce d'un Mozart…"
Extrait, 1960
Sans date
La conscience de ma vocation littéraire date, je pense, de ma quatorzième année, de la découverte quasi simultanée, grâce à notre professeur de troisième et de quatrième à Saint-Michel, l'Abbé Gachet, du Virgile bucolique et de la poésie de Francis Jammes. J'ai compris alors que je n'avais d'autre raison d'être et d'autre tâche sur terre que de reprendre et continuer leur chant. Il n'entrait dans cette certitude aucun orgueil, car je sentais trop combien j'étais démuni et quel travail héroïque et secret je devrais m'imposer, pendant longtemps peut-être, pour me former un langage. Bien sûr, les lectures que nous faisait notre maître, les livres qu'il nous prêtait généreusement, les textes superbes de Colette, de Chateaubriand, de Barrès, de Claudel que véritablement il nous offrait lors de la dictée hebdomadaire, et sa propre ferveur aussi, me fournissaient des modèles et soutenaient mon courage. J'ai conservé le petit carnet où, l'année suivante, après avoir traduit avec l'Abbé Morand, grand latiniste, une dizaine d'odes d'Horace dont la dernière, je méditais avec tremblement sur l'"exegi monumentum aere perennius" et le "non omnis moriar"... Cependant c'était là, autant qu'un point de départ, un aboutissement. Virgile donnait un sens nouveau à l'éblouissement de mes enfances campagnardes et à l'ivresse solaire de mes étés, et les autres aussi dans leur diversité me montraient que tout ce qui se vit de plus intense peut trouver sa forme et son repos dans la langue des dieux. L'extrême maladresse de mes tentatives à la fois me désespéraient et mobilisaient mon courage. Je recommençais. J'ai dévoré tous les livres. J'ai brûlé plusieurs cahiers de poèmes et de commentaires, enthousiastes mais vraiment trop naïfs, de mes lectures.
* * *
... Et je me souviens qu'enfant, dès l'âge de cinq ans, longtemps avant de découvrir l'usage pur et somptueux qu'on peut faire du langage, je dessinais durant des heures, couché sur le carreau, tout entouré de mes crayons et de mes feuilles, des scènes de la vie rurale telles que je les observais autour de moi et particulièrement à la ferme et sur le domaine de mon oncle Nestor: on chargeait un char de foin, on moissonnait, ou bien l'on poussait les vaches à l'abreuvoir, et cela toujours sous un immense soleil qui dévorait la moitié de mes ciels. Moi habituellement turbulent, je m'appliquais en silence, pénétré du sentiment d'accomplir une fonction mystérieuse qui me séparait, qui me mettait à part des autres. Il me semblait que par le dessin je possédais un pouvoir magique, que ces autres ignoraient, et qui plaçait sous ma dépendance et possession tout ce que je figurais sur le papier. Cela me dispensait des soumissions auxquelles étaient astreints les autres ; je me sentais secrètement investi de responsabilités plus hautes et plus exigeantes. On rira de mes prétentions enfantines, que Maman seule sans doute devinait et comprenait parce qu'elle avait cru me perdre. Je dirai pourtant qu'il n'y avait alors en moi aucune infatuation, plutôt la gravité et la ferveur d'un servant de messe, d'un lévite enfant admis au seuil du temple.
* * *
Le grand chêne noir, décharné, est pris comme un fossile dans le bloc cristallin de l'air matinal.
Extrait, 1964
Ciel bleu, d'une douceur unie. Le soleil peint chaleureusement les prés ras où l'herbe repousse. Je vois Praroman dans les arbres, le clocher presque masqué par l'énorme tilleul multicentenaire, les toits et les pans de murs que jaunit la lumière horizontale du soir. Sur l'ocre qui blanchit des champs fauchés la double touffe très sombre de jeunes chênes ; d'autres champs alignent des pyramides de gerbes qui font de longues ombres ; d'autres, non coupés encore, frémissent sous le tiède vent léger. Le front de la forêt est comme une falaise obscure et fraîche. Je voudrais être le Corot ou le Pissarro des lettres, et le poète de cette calme clarté d'un soir d'août
Expo.02 racontée à mon fils
A son fils, né en 02, Alain Chardonnens, l'auteur du Guide du Pays des Trois-Lacs, paru aux éditions de l'Aire, désirait offrir cette description empirique, subjective et anecdotique des cités éphémères d'une expo évanouie de nos paysages. Il a donc sillonné tous les arteplages, patienté à toutes les queues, lu tous les articles pour vous offrir une véritable chronique de cet étrange temps jadis. Une occasion de (re)vivre, de (re)sentir simplement à travers son regard, les doutes, les beautés et les polémiques suscités par "notre" Expo.02.
Extraits
Morat - Instant et Eternité
Incontestablement, en parcourant l'arteplage de Morat, on se croirait dans un port. Devant la porte de Berne, trônent des containers empilés les uns sur les autres: ils abritent les locaux de l'Office du tourisme, de l'accueil et de l'expo-shop. On s'attend à voir les dockers surgir à tout moment pour les transporter dans des cargos. Cette impression de docks est renforcée par les lourdes chaînes rouillées qui longent les trottoirs du giratoire, de l'auberge de l'Ange (Enge) jusqu'au Schiff, histoire de dissuader tout parking sauvage. Après avoir dévalé le Raffor, les bords du lac offrent au regard de nouveaux containers: le stand photo, devant lequel Lili, la mascotte d'Expo.02, est assise, ainsi qu'un nouvel expo-shop caractérisé par toute sa palette de produits dérivés (t-shirt, boîte à musique, bock à bière, toutes les pièces étant frappées du logo de l'Expo). Quelques dizaines de mètres après le débarcadère, l'impression angoissante des docks fait place à une promenade à lamelles blanches. Pour un peu, on se croirait déambuler le long d'un bord de mer d'une petite station balnéaire californienne, peut-être Ocean Beach. Et puis, alors que deux piles de gravats se détachent - le théâtre des Graviers abrite les armoires magiques de "Gli Universi Sensibili" et du "Temps des Escargots" -, on ne peut être que happé par le vaisseau fantôme de l'Expo, le mésoscaphe d'Auguste Piccard. Rongé par le temps, vieille épave qui s'est exilée de longues années au Texas alors qu'il avait été l'une des principales attractions de l'Exposition nationale de 1964, le mésoscaphe fait peine à voir et trouble les personnes âgées qui mesurent avec amertume l'usure du temps. Morat et son port. Les docks imaginaires s'agitent: un lourd paquebot rouillé fend la brume et montre son intention de mouiller à quelques encablures des berges: c'est le Monolithe de Jean Nouvel.
Le Monolithe
Ce cube rouillé d'une arête de trente-quatre mètres - il atteint la hauteur d'un immeuble de douze étages - est l'attraction par excellence de l'arteplage de Morat. Il est, avec les Tours de Bienne, les Galets de Neuchâtel et le Nuage d'Yverdon-les-Bains, l'icône d'Expo.02. En d'autres termes, ce cube, tout droit sorti du film 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, devrait vraisem-blablement habiter un espace de la mémoire du visiteur jusqu'au dernier de ses jours. Il est vrai qu'il est impressionnant. A couper le souffle. Dans la file de badauds qui attendent patiemment leur tour pour prendre pied sur l'embarcation qui les emmènera dans le ventre du Monolithe, j'ai la joie de reconnaître une famille du village voisin, membre de l'UDC locale. Alors que le parti de Christophe Blocher s'est opposé aux centaines de millions de francs de rallonge demandés par la direction de l'Exposition nationale, la maman me déclare qu'elle s'y rend chaque semaine. Quand le vin est tiré, il faut le boire. L'Exposition nationale est là pour cinq mois, alors autant la visiter, voire la savourer, plutôt que de la bouder. L'UDC locale est donc soluble dans les eaux du Monolithe. La petite embarcation quitte le quai et, en moins d'une minute, contourne d'est en ouest le Monolithe, vaisseau sorti tout droit du néant. Entrons. Une fois que les yeux se sont habitués à la pénombre, on se prend pour Jonas dans le ventre de la baleine. Mais dans une cavité non pas de chair, mais métallique, pourvue d'un écran circulaire de huit mètres de haut et vingt et un de large. Les images de "Panorama Suisse version 2.1" inondent les pupilles: une pluie de géraniums, des vues de chalets et de montagnes, quelques scènes d'attente dans une gare: une présentation artistique de la vie quotidienne des Suisses au seuil du XXIe siècle. Cherchant mon chemin dans l'obscurité, redoutant de trébucher sur une personne qui aurait eu la mauvaise idée de se trouver assise sur mon chemin, je me dirige vers les escalators qui m'emmènent dans les étages supérieurs de la baleine. Seules les lumières verdâtres émanant des escaliers balisent le lieu. Pour un peu, la pénombre deviendrait étouffante. J'avale plusieurs étages. Et c'est le choc. Je me retrouve en pleine bataille, celle opposant les Confédérés aux armées de Charles de Bourgogne. Il s'agit d'un affrontement qui va durablement modifier le visage de l'Europe. La Lotharingie et les Etats bourguignons disparaîtront définitivement. Cette Europe médiane faisant office d'Etat-tampon entre la France et les Allemagnes ayant disparu, il n'y aura plus de rempart entre Marianne et Germania, entre le coq et l'aigle. Et si finalement la Bataille de Morat, comme celle de Grandson et de Nancy, portait en elle les germes destructeurs des guerres franco-germaniques de 1871, 1914 et 1939? Personnellement, je répugne à parler de Charles le Téméraire. Je préfère plutôt évoquer Charles le Hardi, comme il est appelé en Belgique. Dans les manuels d'histoire helvétiques, l'écolier apprend qu'un choc manichéen a eu lieu le 22 juin 1476: le bien - les Suisses - a eu raison du mal, incarné par la Bourgogne. Et pourtant, à y regarder de plus près, Charles n'était-il pas l'allié de la Savoie, qui cherchait à contrer les assauts des cantons alémaniques? Charles ne défendait-il pas les intérêts des pays romands contre les prétentions des voisins germanophones de l'est? Voilà qu'en 1536, rien de moins qu'un demi-siècle plus tard, le Pays de Vaud tombait sous la coupe de l'Ours bernois et ce, pour une durée de trois siècles et demi. La bataille fait rage. Elle se déroule sur une gigantesque toile circulaire de cent onze mètres de long sur dix mètres et demi de large. Elle a été réalisée par Louis Braun durant les années 1893-1894. La violence est parfois si crue qu'il était déconseillé, à l'époque, aux femmes enceintes, aux enfants et aux âmes sensibles de venir la contempler. Les détails sont légions et les étendards claquent au vent: je reconnais, outre ceux de la Confédération helvétique, les drapeaux de Lorraine, d'Angleterre, de Cerlier, de Laupen, de Sursee et de Bienne. Quelques personnages également: les commandants helvétiques Hans Waldmann et Hans de Hallwyl, l'ambassadeur espagnol Lucena, et René, le duc de Lorraine. Habitant la région, les villages de Courgevaux, de Faoug et de Meyriez me sont familiers. Tout comme le Vully et le Jura en arrière-plan. Un enfant bien éveillé demande à ses grands-parents gênés qui sont ces femmes à la poitrine découverte sortant des tentes… Un visiteur fribourgeois fait part de son vif mécontentement: le drapeau bernois flotte sur le château de Morat. La toile de Braun, en mauvais état, a dormi de longues années dans le Werkhof de la ville de Morat avant d'être restaurée par la Fondation pour le Panorama de la Bataille de Morat. Une fois l'Exposition nationale terminée, qu'adviendra-t-il de l'oeuvre? Dans quelles nouvelles caves le Téméraire et ses armées vont-ils dormir durant des décennies? Décidément, Morat reste le tombeau du Grand Duc d'Occident…
La messe câline
Ce deuxième livre de Gérard Falcioni est la poursuite, à travers l'écriture, d'une quête de vérité. Il explique ses intentions et la genèse de La Messe câline dans la lettre qui suit:
"A la suite de la parution de L'établi de la vie, je m'attendais à vivre un hiver paisible dans la blancheur de nos montagnes. Mais certaines rencontres et de nouvelles révélations allaient contrarier mes espérances.
D'abord la position de l'évêque de Sion qui, par ses excuses hautaines et ses regrets de mijaurées, n'a fait que conforter certains notables dans leurs convictions que nous, les anciens enfants abusés par des prêtres, ne sommes que des "bons à rien semeurs de m." (remarque qui m'a été faite publiquement) et, pire encore, des cas isolés exagérant dans leurs dénonciations.
Les témoignages que j'allais pourtant recevoir, et qui se sont échelonnés durant tout l'hiver 2002 - j'en reçois encore maintenant - m'ont démontré que les problèmes de pédophilie au sein de l'Eglise suisse, même s'ils sont le lot d'une minorité, anéantissent en toute impunité des vies sous nos yeux.
J'ai reçu des témoignages abondants, émanant surtout de Valaisans et de Fribourgeois, parfois depersonnes de plus de septante ans. Il y en a qui me sont parvenus de Hollande, de Belgique, d'Italie, du Portugal, du Brésil. Certains sont d'une réalité et d'une cruauté insoutenables. Combien de vieux, ici en Valais, m'ont confié, les yeux perdus dans le lointain: "Oui, si les vieux pouvaient délier leurs langues". Et combien de personnes de ma génération se souviennent de mises en garde de leurs mères les invitant à ne pas s'attarder dans la sacristie après la messe?
Dans un village, l'instituteur abusait de certaines petites filles. Lorsqu'elles s'en ouvraient, dans le seul lieu où elles pensaient pouvoir le faire, le confessionnal, c'est le curé qui couvrait l'instituteur.
Je continue à comprendre ceux qui ne peuvent pas croire que cela existe, mais je considère en même temps que l'ampleur de cette réalité et sa gravité, qu'on essaie de minimiser, ne peuvent demeurer cloîtrées dans l'ombre du confessionnal ou du cabinet de psychiatre: "Des destins qui basculent en entraînent d'autres".
J'allais apprendre aussi comment la porte de l'évêché avait claqué aux nez des quelques mamans qui tentaient de dénoncer ces abus, que certains enfants avaient réussi à articuler. On leur répondit: "L'évêque ne peut vous recevoir mais, vous savez, les enfants oublient vite".
J'allais apprendre encore que le pauvre prêtre en question avait été déplacé dans une quatrième paroisse alors que je me souviens que mon père avait expressément demandé qu'il soit tenu à l'écart de tout contact avec des enfants. Lors de ce dernier ministère, l'évêque de Sion était le cardinal actuel.
Enfin, une lettre de la régente qui avait, en son temps, dénoncé les atteintes envers des enfants, allait déposer en moi une gerbe de dégoût et de révolte. Elle perdit alors son emploi et n'en retrouva plus.
A ceci venait s'ajouter qu'il ne s'est pas passé une semaine, durant cet hiver 2002, sans qu'une femme me confie avoir été abusée durant son enfance.
Je ne suis pas du tout préparé à recevoir et à répondre à de telles confidences. La plupart du temps, je ne pouvais que bafouiller quelques mots et m'en aller. Je n'avais pas mesuré les retombées de ma décision de publier mon témoignage.
Une révolte bouillante grondait en moi. Convaincu que la haine et la violence ne sont qu'un héritage du passé, je voulais les dépasser. Je griffonnais le soir, quelques mots, quelques lignes, afin de lutter contre la confusion et le désespoir qui m'habitaient. Je savais que je ne pourrai plus faire ou vivre "comme si de rien n'était" mais je ne savais pas que faire.
A la fin de la saison d'hiver, je me suis un peu évadé dans les montagnes. Puis, durant la semaine suivant Pâques, un premier texte a jailli, en quelques jours: L'enfant tout de blanc. Ce texte a coulé comme un ciel qui pleure et je décidais de le dédier à Gilles K. dont le témoignage m'avait bouleversé au début de l'hiver.
Je n'arrivais pas à croire ce que j'écrivais et pourtant je savais que c'était vrai. Mon corps s'est alors recouvert de plaques rouges et purulentes. J'ai eu peur.
Avant d'aller voir un médecin, et comme mon éditeur précédent refusait d'entrer en matière, je décidais d'envoyer ce petit manuscrit à quelques journalistes qui m'avaient approché lors de mon témoignage. Il devait absolument être lu, être su, quoi qu'il m'arrive. C'est alors que j'eus besoin d'aller voir "La toute vieille femme". Visite qui deviendra le sujet de la deuxième partie de mon manuscrit.
L'écriture de celle-ci m'a été plus ardue. C'était comme aller creuser un siècle qui me parut soudain opaque et obscur. Il m'avait transmis la culture qui me constitue. L'ai-je perpétuée par attachement au confort? Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas eu besoin d'appliquer la pommade à base de cortisone que le médecin m'avait prescrite.
Ce qui est sûr aussi, c'est que ma pensée allait se fixer désormais, à la relecture de ma vie, sur des évidences et des certitudes qui me font trembler. N'avais-je pas obéi et cru plutôt que réfléchi? La répression de la satisfaction génitale qui survint après y avoir été forcé (et, horreur, avec consentement) engendre une culpabilité tenace et morbide.
S'il pouvait finir ce temps où tant de petits dieux dansent sur le plancher de la misère, là où tant d'autres cherchent à être.
Dans sa lettre la régente a glissé, lorsqu'elle me confiait avoir essayé de dénoncer les actes de pédophilie: "Je m'excuse, mais j'ai dû vivre comme une criminelle le restant de mes jours". Moi je m'excuse aussi de devoir écrire ce livre. Il ne faudrait pas que ces choses existent, à tel point qu'on les nie et qu'on les cache comme des destins oppressés ou des bombes soudaines sur les caprices du mensonge."
Gérard Falcioni
La tête des nôtres
Les portraits fribourgeois n'avaient plus été exposés dans une telle ampleur depuis 60 ans.
Le livre richement illustré qui accompagne l'exposition La Tête des nôtres est une remarquable synthèse du genre.
Quel rapport entretenaient le portrait peint et la photo à l'apparition de cette dernière? Quel était le rôle social des représentations individuelles et collectives? Quelle vision de la société se dégage du corpus des portraits fribourgeois? Les soixante premières pages du livre, avec leur 56 illustrations, répondent à ces questions et à bien d'autres qui fixent le cadre général - historique, social et artistique - dans lequel s'insère la riche production de portraits dans le canton depuis 1850. Dans la deuxième partie, soixante destins individuels racontent autant de "chapitres" de l'histoire du canton. Un texte d'une page accompagne chacune des œuvres publiées en pleine page. Les auteurs - Verena Villiger, Jean Steinauer et Caroline Schuster Cordone - ont enquêté sur les personnages et les groupes représentés. On y découvre Alexandre Charles Buntschu, Jean-Marie Musy, Edouard Guhl, Victor Tissot, Joseph Piller, la merveilleuse Marie Blaser-Gloedlin, le vendeur de la loterie romande, la famille de paysan, la société de gymnastique… Les uns sont extrêmement connus, il ne reste des autres que quelques souvenirs. La Tête des nôtres les fait mieux connaître, aimer parfois. Les grands artistes fribourgeois - Hiram Brülhart, Raymond Buchs, Alfred Lorson… - apparaissent tout au long du livre. Mais la présence de Balthus, d'Hodler, de Vallotton parmi les portraitistes, d'hommes et de femmes venus d'ailleurs parmi les personnages représentés, ouvre la porte d'un espace fribourgeois envisagé dans des frontières larges. De passage ou intégrés pour longtemps, ils font tous partie de cette histoire fribourgeoise racontée par le portrait dans ce magnifique livre.
Un livre de Verena Villiger, Jean Steinauer et Caroline Schuster Cordone (116 illustrations dont la plupart en couleur et 65 en pleine page).
Le martyre du Pape Kevin
"Le nouveau pape a 32 ans. On le prétend plus à l’aise sur une planche de surf qu’à l’heure de dire la messe et il semble préférer les scènes de concert au balcon de Saint-Pierre. Au Vatican, on s’arrache les cheveux, mais le pape est à la mode et des foules de jeunes convertis se pressent dans les églises."
L’Église catholique a convié des consultants à son chevet. Ils arrivent le front haut, munis de concepts et de solutions, sûrs de leur fait. Mais les remèdes à action rapide du monde libéral sont-ils vraiment adaptés à la vieille dame de la chrétienté ? Peut-on s’adresser aux croyants avec un oeil sur des statistiques et l’autre sur un plan de communication ? Une frange de l’Église a décidé de parier que oui.
Le produit de cette rencontre entre l’âme et le portefeuille est un pape de 32 ans. Kevin premier est formaté pour séduire les foules sur des rythmes techno, pour chanter le tube de l’été tout en ramenant la jeunesse au bercail. Et le miracle se produit. L’Église trouve un souffle nouveau et surfe avec son pape sur la vague du succès.
Mais l’immédiat se passe difficilement de l’éphémère. Et l’Église se retrouve alors face à un défi autrement compliqué. Ce pape trop jeune et trop aimé, il va falloir le faire durer.
Le martyre du pape Kevin est une joyeuse immersion dans ce choc des cultures, un roman qui nous propose en outre une galerie de personnages intrigants, attachants ou franchement ridicules. Satire sans doute, caricature bien sûr, mais on se prend parfois à penser que même dans l’absurde et la gaudriole, on ne se trouve pas bien loin du réel.
Les chevauchées du colonel Koenig. Un aventurier dans l’Europe en guerre 1594-1647
Les éditions faim de siècle publient un ouvrage qui tient du roman et de l’enquête historique minutieuse : Les chevauchées du colonel Koenig. Un aventurier dans l’Europe en guerre 1594-1647.
Verena Villiger, Jean Steinauer et Daniel Bitterli ont reconstitué le destin et l’itinéraire tourmentés de François-Pierre Koenig (1594-1647), cet homme de guerre et de gouvernement qui, formé à Fribourg, sillonna bien vite une Europe du XVIIe siècle aux prises avec la guerre de Trente Ans. Commanditaire du premier portait équestre dans l’histoire de l’art suisse, F.-P. Koenig sait se mettre en scène, et sa vie tient du roman de cape et d’épée avec des aventures qui le mèneront de la Hongrie à la Franche-Comté et de l’Adriatique à la Baltique. Son parcours permet au lecteur de s’immiscer tout aussi bien dans l’histoire locale fribourgeoise – il occupa la plus haute charge de l’Etat – que dans celle d’une Europe en mutation.
Cette publication accompagne l’exposition intitulée Koenig! La guerre, la gloire, la foi - Für Glauben,Ruhm und Krieg qui se déroula du 29.09.2006 au 28.01.2007 au Musée d’Art et d’Histoire de Fribourg.
1824-1933: la verrerie de Monthey. Ouvriers, patrons et syndicats
Dans un canton tenu jusqu'alors à l'écart du monde industriel, la création et le développement de la Verrerie de Monthey (1824-1933) représentent une véritable petite révolution. L'ouvrier succède à l'artisan, l'usine à l'atelier. Posant le premier jalon de l'important développement de la place industrielle du Chablais, la Verrerie témoigne du rôle pionnier joué en Valais par des générations d'entrepreneurs et d'ouvriers étrangers. Face à une dynastie patronale qui tâche de s'adapter aux mutations économiques, le petit monde ouvrier lié à ce pénible métier s'organise. Pour la première fois les mots "grève", "syndicats", "kroumirs" résonnent dans un Valais qui découvre le drapeau rouge.
Par Virginie Balet
Pour ma génération, "La Verrerie" n'évoque plus que le nom d'un centre commercial de Monthey et d'une rue adjacente. Pour celle de mes parents, elle représentait le plus fantastique espace de jeu que Monthey ait eu à proposer à sa jeunesse: un terrain vague et des bâtiments abandonnés regorgeant de trésors de verre et de papier… L'écrivain Jean-Luc Benoziglio, né à Monthey en 1941, en donne un description saisissante dans son ouvrage Quelqu'unbis est mort paru en 1972:
"De l'autre côté de la rue, quelqu'un pouvait également voir une baraque à demi-effondrée, énorme chose en ruine qui dressait vers le ciel ses squelettes d'escaliers, ses poutres semblables à l'os qui traverse la peau, ses cheminées pourries et pas mal d'herbes folles. Des moutons y paissaient sans doute obscurément. Ou des vaches. Quelque chose, en tout cas, à quatre pattes, et qui broute. L'embarras du choix. Au dire ce ceux qui savaient, cette ruine ou ce qu'il restait de cette ruine, aurait été une fort célèbre verrerie. Elle avait connu, semble-t-il, son heure de gloire vers l'an mille neuf cent. Détail piquant, les verriers étaient saouls d'absinthe de l'aube au couchant. Ah, les braves gens. Quelqu'un restait parfois des heures à contempler la verrerie, se demandant peut-être si, longtemps encore, elle surnagerait au déluge, si, longtemps encore, ces fantômes au torse nu et aux joues étrangement gonflées emboucheraient leur tube et souffleraient, avec l'application grave des batraciens à la ponte, des araignées cristallines, flûtes de poussière, rouille en hanaps, relents d'alcool, si, longtemps encore, la lueur rouge montant des fours se loverait aux carreaux cassés et y plaquerait des madones en vitrail sitôt éteintes (déshabillées ?) par la pluie."
Mes grand-parents et leurs contemporains se souviennent tout juste d'avoir vu de la fumée sortir de ces hautes cheminées. Et seuls leurs parents auraient pu nous parler des gens qui y travaillaient et de l'ambiance qui y régnait.
Alors que pendant plus de cent ans, la Verrerie a joué un rôle majeur dans l'industrialisation, non seulement de la localité, mais aussi de la région, rares en sont les témoignages aujourd'hui visibles en ville de Monthey. Des deux emplacements de l'industrie verrière, seul le site de la Verrerie de la Gare est passé en une discrète postérité qui l'empêche de tomber dans l'oubli: la rue qui longeait l'entreprise a pris son nom, tout comme le centre commercial qui s'y est élevé en lieu et place.
La main d'œuvre, un surprenant mélange de Montheysans, de gens de la région et d'étrangers - Français et Italiens surtout, mais aussi Prussiens, Hongrois, Hollandais - a contribué à l'atmosphère particulière qui régnait à la Verrerie. Des familles entières, parfois sur plusieurs générations, y ont travaillé: les familles fondatrices bien entendu, les Contat, Seingre, Trottet et Franc; mais aussi des familles comme les Boissard, Chappex, Coppex, Delmonté, Duchoud, Gallay, Garny, Rigoli et Voisin, entre autres, qui ont fourni maints ouvriers et employés.
Difficile, aujourd'hui, de s'imaginer que certains Montheysans égalaient les verriers vénitiens de Murano en savoir-faire et en finesse d'exécution. Carafes élégantes, vases à fleurs tarabiscotés et coupelles à fruits taillées ont côtoyé, sur les rayons des magasins de la Verrerie, fioles à médicaments, urinoirs, biberons, bocaux à confiture et autres chopes de bière et bouteilles de lait. Bien que reconnue comme faisant partie de l'histoire de la ville, la Verrerie est restée largement méconnue et ceux qui ont œuvré à son développement et à sa prospérité sont pour la plupart passés dans l'anonymat. Loin de prétendre à une présentation complète et définitive de la Verrerie de Monthey, de ses conditions de travail et de ses employés, cet ouvrage rend hommage aux acteurs de l'industrialisation montheysanne.
La ligne blanche & Genèse 4
Les éditions faim de siècle ont le plaisir de publier en un volume deux pièces de théâtre du jeune écrivain Bastien Fournier (1981), La Ligne blanche & Genèse 4, deux ans après la parution de son premier roman La Terre crie vers ceux qui l'habitent.
Cette édition accompagne la présentation du 24 mars au 9 avril 2007 de Genèse 4 sur les planches du Petit théâtre de Sion, et fournit l'occasion de découvrir une autre facette de l'activité littéraire de Bastien Fournier.
Que cela soit au travers d'un monologue retraçant différents épisodes de la vie d'une épouse de footballeur ou par la présentation de l'affection ou de la haine qu'éprouvent deux frères l'un envers l'autre, Bastien Fournier parvient toujours à interpeller son public et à susciter la réflexion en présentant des personnages qui restent férocement humains avec leur colères et leurs violences.
A travers son écriture, l'auteur valaisan souhaite faire partager sa vision de l'être humain, toujours soumis au contexte dans lequel il évolue.
Cette publication comprend également une postface de Jean-Michel Roessli. Ce spécialiste des sciences des religions apporte un éclairage érudit à propos des énigmes soulevées par ce quatrième chapitre de la Genèse évoquant Abel et Caïn, source d'inspiration de Bastien Fournier et de nombreux écrivains à travers les siècles.
Entretien avec Bastien Fournier
Ce qui surprend le plus au moment de rencontrer Bastien Fournier, c'est sa capacité à glisser quelques instants de calme, avec l'aide d'une cigarette et d'un café, dans un emploi du temps très chargé pour parler de son travail avec un enthousiasme extrêmement communicatif. A l'occasion de l'édition de ses pièces La Ligne blanche et Genèse 4 et de la présentation de cette dernière sur les planches du Petithéâtre à Sion, l'écrivain romand s'est prêté sans difficulté au jeu des questions et des réponses.
"Une comédie avec un aspect tragique"
Il prend une rapide bouffée de fumée avant de se lancer dans cet exercice de style et de fournir le fil rouge de La Ligne blanche: ''Même si je ne suis pas un véritable mordu de football, j'ai effectué mes classes juniors avec le FC Fully comme latéral gauche et j'ai toujours eu un certain intérêt pour ce sport. Dans les faits, La ligne blanche est une commande qui m'a été faite à l'occasion de Fetartista et comme le budget était modeste, j'ai choisi de lui donner la forme d'un monologue. De plus, cette commande a pris place au cours de l'été 2004, durant l'Eurofoot. Je me suis donc retrouvé dans une période propice à l'écriture avec les potins dans les journaux. D'un point de vue plus personnel, j'ai toujours aimé le côté épique, même héroïque qui compose le football.''
Les amateurs de football pourraient avoir de la peine à se reconnaître dans la pièce de Bastien Fournier et les événements qu'elle relate. A cela l'auteur répond: ''Tout ce que l'héroïne de la pièce déclare est tiré d'anecdotes médiatiques ou d'histoires personnelles qui m'ont été rapportées. Tout est vrai, y compris la polémique sur la couleur des cheveux des joueurs. Cet assemblage d'anecdotes donne un côté tragique incarné par l'épouse du footballeur. Celle-ci a un côté ambigu: elle aime son mari footballeur pour ce qu'il est et c'est ce qu'il est qu'elle déteste. Dans les faits son mari est un homme ridicule en raison de son attachement à son apparence. Mais cet homme est un mythe qui est déconstruit au long de la pièce. Avec cette déconstruction, La Ligne blanche est une comédie avec un aspect tragique. Je ne voulais aussi ne pas aller trop loin car si le mari footballeur a ses défauts et ses petites faiblesses qui sont insupportables pour sa femme, il reste très amoureux de celle-ci.''
Dans la foulée des premières représentations, Bastien Fournier a reçu un grand nombre de réactions contrastées: ''J'ai eu un écho très positif de la part des spectateurs de football qui ont ressenti dans la pièce ce qu'ils ressentent en tant qu'observateurs du sport. Par contre, les personnes qui sont elles-mêmes impliquées dans ce sport m'ont reproché d'en donner une image peu reluisante. On pourrait dire que le public des stades s'est plus reconnu que les footballeurs eux-mêmes.''
" Une action citoyenne "
La discussion change quand on aborde la seconde pièce et son thème du fratricide: ''De par l'orientation de mes études en littérature, ce thème m'a toujours intéressé. Pour être exact, j'ai été attiré par les textes qui relatent le passage du monde païen vers le chrétien. De plus, le texte de la Genèse qui se trouve dans la Bible offre beaucoup de possibilités pour une adaptation au théâtre car il contient une foule de passage où les explications manquent. Il y a donc de la place pour la poésie. Et la thématique des frères ennemis m'a beaucoup interpellé car elle pourrait être rapprochée avec l'histoire de l'humanité.''
Si le lecteur de la pièce vient à souligner le côté sombre du texte, Bastien Fournier tient à lui opposer un point de vue un peu plus nuancé: ''Je ne pense pas que l'être humain soit bon ou mauvais, il réagit en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Dans la pièce, le public voient deux frères qui s'aiment, mais que la situation dans laquelle ils se trouvent va les amener à se détester. C'est un enchaînement absurde est qui est perçu comme tel par les protagonistes. La violence submerge l'être humain, c'est une force irrationnelle qui s'empare des gens, comme une forme de colère. La pièce est un peu pessimiste car cette violence est absurde. Mais elle contient aussi de l'optimisme car la violence n'empêche pas l'Amour. On ne déteste que ceux qu'on aime. Mon intention est de susciter un débat chez les personnes qui viendront voir cette pièce, pas d'apporter des réponses. Quel élément peut freiner la violence qui vient s'insérer dans la trame de la pièce? Vorace va chercher la justice pour ce qui lui arrive. Car si son premier meurtre est commis par jalousie, le second est une sorte de réparation suite aux actes de son frère. Je serai heureux si le public sort du théâtre en s'interrogeant sur la limite de la justice. D'une certaine manière, susciter cette réflexion est, pour moi, une forme d'action citoyenne.''
Au moment de découvrir Genèse 4 sur scène, une question vient rapidement à l'esprit: de quelles sources l'auteur valaisan tire-t-il les éléments qu'il a utilisés pour palier le manque d'explication du texte biblique? ''En fait, je me suis peu renseigné sur le sujet, précise l'intéressé, le texte original suscite des questions depuis des siècles. Un lecteur m'a fait remarquer qu'il y trouvait une lecture typologique des textes bibliques. La pièce aborde un événement relaté dans l'Ancien Testament qui préfigurerait ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Mais je pense pour ma part que c'est une histoire avant tout très humaine entre deux frères, c'est une tragédie familiale en milieu clos en non une pièce théologique. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai changé les noms. Le thème central de la rivalité est très présent dans la culture occidentale.''
Propos recueillis par Xavier Lambercy, 18.02. 2006 (article libre de droit)
Saint-Nicolas: les aventures du patron de Fribourg
Chaque premier samedi de décembre, des milliers de Fribourgeois se rassemblent au cœur de la vieille ville pour participer à la traditionnelle fête de Saint-Nicolas.
En 2005, pour la centième fois exactement, le patron de la cité triomphe. A cette occasion, nous avons publié un ouvrage magistral réalisé sous la direction de l'écrivain et journaliste Jean Steinauer, Saint Nicolas, les aventures du patron de Fribourg.
Avec une iconographie variée à l'appui, les auteurs répondent aux questions qui taraudent ceux qui ont eu l'occasion de participer à ce grand rassemblement : comment ce saint particulier fut-il adopté par les Fribourgeois? Le rituel de cette fête est-il vraiment immuable? Que diable peut donc ressentir saint Nicolas lorsqu'il s'adresse à la foule du haut de la cathédrale?
Vous y découvrirez tout ce que vous vouliez connaître du parton de Fribourg, sans toujours savoir à qui le demander!
Lonely
Vous arrivez dans une ville inconnue, ville que vous n’avez encore jamais rencontrée, où tout est complètement neuf... Les odeurs, le vendeur de hot-dogs, les transports publics qui vous conduisent dans des eauxinconnues. Dans ces rues longues et pleines, vous devez gagner la confiance Dans un tel moment de vide, l’achat d’un guide de voyage à l’Office du tourisme peut aider. Ce ne sera pas le premier de votre collection. Vous en avez déjà plein la maison. Le plus souvent, le guide s’avère plutôt décevant. Au final, il ne vous laisse pas de grands souvenirs.
Lonely se distingue. Il répertorie les terrains verts de la ville comme le ferait un botaniste. C’est une forme d’inventaire.
Terrains intermédiaires
On les frôle, on les croise, on s’y prélasse. Mais y prête-t-on attention? Comme un touriste fraîchement arrivé, à l’esprit curieux et avide de surprises, Lonely part à la rencontre de lieux intermédiaires non classifiés. Projet artistique d’abord, l’ouvrage se parcourt comme un guide de voyage. Mais aussi un – faux? – guide inédit, particulièrement original pour surprendre les habitants et visiteurs.
Lonely c’est peut-être aussi la lumière si particulière qui traverse le branchage en été. Avec une certaine moiteur mêlée de promenades. Radicalement, comme une fin du monde. Décliner ce grand inventaire, c’est sacraliser le présent comme si un jour tout devait disparaître.
Concept et idée: cramatte.com
Direction artistique: rmgdesign.ch
Maquette Book Design: drawingplan.ch
Photographie et textes: Jean-Luc Cramatte, Urs Graber
Les naturalistes fribourgeois sortent de leur réserve
En accompagnement d’une exposition en 2006 au Musée d’histoire naturelle de Fribourg, les éditions faim de siècle ont publié Calepin, loupe et filet. Les naturalistes fribourgeois sortent de leur réserve! Ce livre signé Laurence Perler Antille raconte, en 128 pages richement illustrées, l’épopée de quelques savants fribourgeois qui ont fait rayonner le canton alors que la Suisse et l’Europe se prenaient d’une nouvelle passion pour Dame Nature. Un retour sur le passé pertinent, alors que le climat et la surexploitation de la planète remettent les naturalistes sur le devant de la scène médiatique.
Jusqu’au XVIIIe siècle, les sciences naturellesnaviguaient entre poésie, fable et mythologie. Le siècle des Lumières opère un virage scientifique majeur. À leur échelle, les naturalistes fribourgeois ont contribué à ce formidable essor des sciences. Par monts et par vaux, armés de leurs calepins, loupes et filets, ils sont sortis de leur réserve pour parcourir inlassablement leur région, collectant les moindres spécimens de flore, de faune et de roche pour ensuite les étudier et les classer. Leurs correspondances et échanges avec d’autres chercheurs leur ont permis de réunir des collections extraordinaires, et nombre d’entre eux ont vu leur réputation dépasser largement les frontières nationales.
Fer de lance de ces pionniers des sciences naturelles cantonales : un ecclésiastique, le chanoine Charles-Aloyse Fontaine. Son avant-gardisme lui vaudra plusieurs réprimandes de sa hiérarchie et l’incompréhension de ses contemporains. Mais il en faut plus pour étouffer son insatiable curiosité. Pas rancunier, il lèguera la totalité de ses collections au gouvernement fribourgeois : le premier musée du canton est né. À sa suite, des dizaines de chercheurs perpétueront cet esprit et cet amour du savoir. Parmi eux, le botaniste Firmin Jaquet, le géologue Raymond de Girard et l’ornithologue Léon Pittet. Leurs engagements ont jeté les bases d’une conscience du patrimoine naturel que plus personne ne conteste de nos jours. Les éléments naturels, et le milieu alpin en particulier, ont également été utilisés pour construire une symbolique forte capable de rassembler un pays. L’edelweiss qui, à l’instar des montagnards helvétiques, résiste si bravement aux rudes conditions alpines, est ainsi devenue l’un des emblèmes les plus usités de la Confédération helvétique.
Rêverie végétale
Après la parution de Lonely du photographe Jean-Luc Cramatte, les éditions faim de siècle vous invitent à découvrir un véritable "livre objet" intitulé Rêverie végétale: un léporello tout en douceur et en poésie contenant 40 images de la photographe fribourgeoise Nicole Chuard, accompagnées d’un texte de Patricia Brambilla, ode à la nature et à la magie d'un espace hors du temps, le jardin botanique de l'Université de Fribourg.
A chaque seconde, mettre ses pas dans ceux de la beauté. C'est-à-dire déceler la lumière brisée, le pastel d'un feuillage, le jet ultime d'une rose, les wagons du ciel ou le crépitement mordoré du début de l'été. Mais qu'est-ce que la beauté, au fond, et pourquoi est-il si important de la dire ? Nul ne le sait, mais nous marchons.
Patricia Brambilla
40 images au format 14 x18cm
Livre objet sous la forme de léporello
(7,4 mètres, une fois déplié),
papier invercote 280 gm2
Pour découvrir le travail de Nicole Chuard: www.nicolechuard.ch
Les 50 oeuvres qui comptent en Suisse romande
La Suisse romande, terre du livre? Le slogan n’est pas usurpé: de Joseph Zyziadis à Darius Rochebin, d’Uli Windisch à Peter Bodenmann, ils ont tous un jour ou l’autre commis un livre ou une galette. Depuis vingt ans, la revue satirique La Distinction recense les œuvres qui ont marqué la Suisse romande, du dernier roman avec pasteur aux essais universitaires abscons d’ici et d’ailleurs. Découvrez aujourd’hui cette sélection aux saveurs d’anthologie. Le compte rendu est un art mineur, mais comme le diable se cache dans les détails, il vaut la peine de l’y découvrir.
Préface des éditeurs
Nous sommes tous en quête de la bibliothèque idéale. Elle fait figure d’ornement indispensable des intérieurs de l’honnête homme et de la femme célibataire, oscillant selon les caractères du capharnaüm organisé aux alignements hiérarchisés. Afin de faciliter sa constitution, la mode flatte aujourd’hui l’esprit d’inventaire, créant les Indispensables de la culture: les 1000 livres qu’il faut avoir lus, les 1000 films qu’il faut avoir vus et les 1000 tableaux que l’on doit connaître. A cette aune, nous ne vous proposons qu’une anthologie de poche, mais de bon aloi: les 50 œuvres qui ont marqué les esprits et comptent encore en Suisse romande. Depuis vingt ans en effet, la revue satirique La Distinction recense ces œuvres, du dernier roman avec pasteur aux essais universitaires abscons. La Suisse romande, terre du livre? Le slogan, vous le découvrirez, n’est pas usurpé: de Joseph Zyziadis à Darius Rochebin, d’Uli Windisch à Peter Bodenmann, ils ont tous un jour ou l’autre commis un livre ou une galette. Le spectre de cette sélection ne se contente pas de hiérarchie régionaliste. Les Alexandre Soljenitsyne, Michel Tournier, Dan Brown, Marguerite Duras et Pierre Bourdieu sont également convoqués à ce singulier tribunal. Le compte rendu est un art mineur, mais il fait encore les délices et les malheurs des acteurs du barnum culturel. On dissèque cet élément de la réception, on classifie ses auteurs, on se gausse in petto des hongres de la critique professionnelle, de la littérature avec ou sans estomac. Ces éléments ont transformé peu à peu le compte rendu en aimable paraphrase ou digestion laborieuse de communiqués de presse prémâchés. La Distinction réhabilite une forme de verve qui vous aidera à trier le bon grain de l’ivraie.
Mort à nos ennemies les bêtes
Tremblez, mémères à leur chien-chien de tous poils! Craignez le pire, grands amateurs d’estomacs inutiles!
Voilà que lassés des ébats télévisés de B.B., écœurés des pitreries animalières de Franz Weber, une association européenne s’est constituée, la Ligue Européenne Anti-Bêtes, avec pour but premier "la libération des zones urbaines de tout animal ne présentant pas une utilité démontrée, c’est-à-dire ne pouvant pas être consommé par l’homme".
La LEAB développe ses thèses dans un pamphlet récemment paru qui n’a pas fini de faire hennir les âmes sensibles. La liste est désormais établie des multiples dégâts causés par les bêtes depuis la nuit des temps: du requin mangeur d’hommes à la sournoise mygale, du pou dégoûtant à la sangsue gluante, du renard enragé au moustique harceleur. Le cheval de Troie lui-même n’est pas épargné: il n’y aurait pas de hasard à ce que des soldats (forme la plus bestiale de l’homme) aient choisi un piège de forme animale afin de s’en aller décimer leurs semblables!
La deuxième partie du livre concerne plus particulièrement le territoire urbain, fief absolu de l’humain où l’animal ne peut vivre au mieux que comme gêneur. Je ne retiens que quelques-uns des exemples proposés, qui apparaissent les plus pertinents. Le chien d’abord est tout spécialement mis à mal. Passant son temps à aboyer bruyamment le dimanche matin, à tenter de mordre les mollets des cyclistes, à déféquer aussi souvent que la nature le lui permet, à uriner chaotiquement de-ci et de-là pour – croit-il – délimiter un prétendu territoire, il est certain que sa présence en ville est impossible à ignorer.
Les pigeons ensuite sont pris à parti. "Chancres aériens", ils répandent leur précieux guano sur les têtes et les édifices, ils collent les mèches et rongent la pierre. Ils perdent leur vilain plumage (trois mues par an) et répandent par là des maladies insidieuses.
Les chats pour finir: ils massacrent les arrangements floraux des cités, miaulent de manière insupportable à la saison de leurs prétendues "amours", détruisent meubles et tapis. Ils pourraient aussi parfois s’en prendre aux nouveau-nés (Le Matin, 7 octobre 1988)!
La LEAB présente un plan d’action: en premier, stériliser tous les animaux urbains, par la nourriture (pigeons) ou par la chirurgie (chiens, chats, hamsters). Dans un second temps, la ligue voudrait accélérer le mouvement en promouvant la consommation généralisée de ce qui peut l’être sans risque: le cheval, le chien et les canaris sont des cochons comme les autres (un livre de cuisine cet automne chez le même éditeur).
La démarche de la LEAB pourrait sembler excessive au premier examen, mais c’est dans la conclusion qu’il faut trouver sa dimension éthique. Partisans d’une "misanthropie douce", ses militants déclarent que l’homme est un animal solitaire, ce qui le distingue de la bête, dont il faut encore sans cesse l’arracher. Cette trop exigeante solitude peut parfois nous amener à des rapprochements excessifs, qui sont tolérables lorsqu’il s’agit de relations entre humains, mais qui sont à condamner fermement lorsqu’ils concernent des animaux. Des expériences de psychiatres américains auraient par ailleurs démontré le rôle du cerveau reptilien de l’homme dans l’affection portée aux bêtes. L’attirance pour les animaux serait un vieux reste de notre condition animale qui irait de pair avec les pires dévoiements de l’humanité. On se souvient trop peu de l’amour que Hitler portait aux bêtes!
Aucune signature personnelle n’a pu être apposée à ce livre, l’éditeur ayant déjà été menacé de représailles par les plus extrémistes animaliers. Une justification supplémentaire à ce pamphlet qui remet avec justesse la viande au milieu de la boucherie!
C. P.
(15.06.1990)
(1) Dr M. Spörly, Les pigeons et la grande peste, Fayard, 1989, 652 p., Frs 46.20
Nos ennemies les bêtes, Favre, 1990, 145 p.
Crooners valaisans
Les politiciens valaisans ont le vent en poupe, c’est indéniable. Comment expliquer ce qui apparaît de plus en plus comme un véritable phénomène de société? Peut-être par une autre approche de la communication politique, faite de convivialité et de proximité, qui ne dédaigne pas les technologies modernes. Ainsi, simultanément, deux ténors des partis minoritaires viennent de sortir leur premier CD.
Sur une musique des fameux Eric Qube et Scoof, Pascal Couchepin égrène sa profession de foi sous un titre énigmatique: Ce qui me rapproche de la gauche. Si le chœur des demoiselles du Collège Sainte-Jeanne-Antide, célèbre pour son festival de jazz, qui répète inlassablement en arrière-fond "Il fait de la politique, c’est un type fantastique…" s’avère un peu lassant à la longue, les credo du nouveau Conseiller fédéral valent qu’on s’y attarde. Ces "petites phrases", disséminées distraitement par le plus connu des Martignyois de Berne, forment, lorsqu’on les met bout à bout, une philosophie politique solidement charpentée qui va plus loin que le pragmatisme à courte vue des décisionneurs archaïques de ce pays. Qu’on en juge plutôt: "Il faut avoir une économie en bonne santé, c’est pour moi un sujet de méditation.", "Il faudra avoir le courage de prendre des mesures impopulaires.", "A la fin qu’est-ce qu’on veut?", "On peut pas refaire le monde à partir de rien."
La finesse d’analyse que révèle une affirmation comme "L’économie au fond, c’est la bonne santé du corps.", bien connue des mangeurs de salade et des adeptes de la cure automnale de raisin, se manifestera certainement dans les décisions stratégiques qui porteront bientôt la patte du nouveau chef de l’économie publique.
Peter Bodenmann a, quant à lui, choisi une démarche plus personnelle et ethnographique. A la recherche de ses origines familiales dans les hautes vallées du Haut-Valais et de segments négligés de l’électorat, il a fini par découvrir quelques familles de bouviers confinés dans leurs alpages, et dont il a recueilli les chants traditionnels. Les plus anciens parlent encore une variante étrange du dialecte régional. Ce patois germanique, localisé autour d’Obertschuggen (2400 m), ne fut jamais écrit, sa transcription pose des problèmes délicats que la pochette résout de façon peu convaincante: "Ound wen di rebe zinkt, zingen ale xasidim; poï, poï, und wen di rebe ist, esen ale xasidim, poï, poï, bom bobobom, oï, oïm."
Accompagné à l’accordéon et au violon par des natifs, l’ancien président du PSS interprète lui-même la plupart de ces morceaux. Si ses qualités vocales confirment la justesse de ses choix professionnels, il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’un document culturel et linguistique exceptionnel. "Le travail de la mémoire qui s’opère ici métabolise à la fois les derniers feux d’une culture paysanne moribonde et les dispositifs sociaux qui folklorisent la métaphore montagnarde tout en dévoilant le refoulement du devenir d’un passé restant l’enjeu de l’invention d’un présent qui interpelle la modernité en mutation", comme l’affirme clairement l’anthropographe Bernard Crettaz dans sa présentation du disque.
J.-F. B.
(5.09.1998)
Eric Qube et Scoof
Couchepin
CD Single, 4’30 et 3’22, prix non-indiqué
Diffusion: Valfredini,
Rue du Simplon 23, 1907 Saxon
Peter Bodenmann
Traditionellen Singen
von Oberwallis von Oben
12 chants (entre 1’60 et 3’00),
précédés d’une introduction historique
de P. Bodenmann (58’00), Frs 26.60
Diffusion: Harmonia Mundi
Lambiel est un plat qui se mange froid
"Chaque fois que je visionne le DVD de Recrosio, je le vois pour la toute première fois, alors que tous les sketches de Lambiel, même ceux qui n’ont pas encore été écrits, sont déjà connus par chacun d’entre nous." C’est par ces mots forts que Raphaël Brunner, de l’ECAV, ouvrait en mars dernier le colloque de la Société Académique tenu à la Médiathèque du Valais. Embarras du jeune sociologue Frédéric Recrosio, puisqu’il était lui-même le maître d’œuvre de cette rencontre dont les actes ont enfin paru aux éditions Faim de Siècle. Il est à noter que ce colloque était financé par le pour-cent culturel du projet "Sion 2006 quand même".
La force des contributions ne manquera pas d’intéresser tous ceux que la technique de Yann Lambiel interroge. "L’art n’est jamais imitation donc l’imitation n’est pas un art. Par sa virtuosité, l’imitation ne peut se mettre en scène qu’en tant que telle. Le drame de l’imitation c’est de ne point entrer dans le drame. Elle ne se rentabilise que dans l’industrie médiatique qui renforce les masses dans leur certitude. Le plaisir de reconnaître en même temps Claude François chantant Sentiers Valaisans et Sentiers Valaisans chanté par Claude François, c’est rejoindre en même temps l’enfance de maman et celle de grand-maman. Yann Lambiel c’est le Gianadda du witz", relevait Claude Roch, chef du DECS au moment de conclure.
On peut donc aujourd’hui retrouver l’intégralité des contributions:
– L’imitation de la misère, préface de Jean-Pierre Tabin, de l’EESP.
– Tout ce que fera Lambiel m’est déjà familier, par Raphaël Brunner, de l’ECAV.
– Lambiel ou le toujours déjà-vu, par Jean-Pierre Keller, de l’UNIL.
– L’auto-absorption narcissique comme effondrement dramaturgique, par Gilles Lipovetsky, de Grenoble-1968 quand même.
– La lyophilisation de la Soupe dans l’Unbewusstseins-Industrie, par Alfred Willener, de l’UNIL.
– Toast porté au repas de midi, par Manuela Maury, bibliothécaire.
– De Lambiel à Couchepin structuration d’un réseau cohérent entre radicalisme et patriotisme, par Emmanuel Lazega, de Lille-1.
– Manque la contribution de Bernard Wyder, d’USEGO.
– Les mérites du cousin Lambiel et la justice distributive, par Jean Kellerhalls, de l’UNIGE.
– Le prêt-à-rire du cliché comique, par Uli Windisch, de l’UDC.
– Hériter de ceux qui héritent, par Christian et Michèle Lalive d’Epinay-Tornay, de l’EMS (emerit master of sociology).
– Décoincer les malheureux, par Claude Roch, du DECS.
– Misère des limitations, postface de Gabriel Bender, de la HEVS.
P. P.
(1.07.2006)
Colloque Lambiel, Faim de Siècle, 2006, 26 p., Frs 17.–
L’être et la nana
Marilyn Monroe est devenue en trente ans une sorte de sainte laïque. On la vénère, on la prie, on la pare de vertus bénéfiques; martyre plus que vierge, elle symbolise un destin exemplaire pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui.
Aux côtés de Coluche et Gainsbourg, elle trône désormais sur les autels privés d’une sorte de religion populaire que les intellectuels patentés méprisent souvent. A l’inverse, guidé par cette sorte d’instinct que lui a donné une vie de sartrologue, Michel Contat nous montre le sens profond d’une rencontre inopinée: celle de Jean-Paul Sartre et de Marilyn.
Les circonstances d’abord. Revenant de son voyage triomphal au Brésil (novembre 1960), le fondateur des Temps Modernes s’arrête quelques jours à Hollywood où il souhaitait retourner depuis cette tournée de mars 1945 que le Département d’Etat avait offerte à divers journalistes parisiens. On sait l’amour immodéré que Sartre portait au cinéma: déjà dans le Discours de remise des prix au lycée du Havre du 12 juillet 1931 – récemment publié et commenté par le même Contat aux éditions Les Introuvables – il conseillait aux bacheliers la contemplation régulière du septième art, fût-ce contre l’avis de leurs parents et du proviseur.
C’est à la pharmacie internationale de Sunset Boulevard, où il achetait sa corydrane quotidienne, que l’auteur de La Nausée rencontra l’actrice de Some like it hot, venue commander ses barbituriques. L’ayant reconnue, Sartre l’aborda pour lui narrer ses expériences personnelles avec la mescaline (à Sainte-Anne en 1935, à la suite de quoi il se crut durablement poursuivi par des langoustes). Marilyn, surprise d’abord par ce "disgusting dwarf" ("nabot repoussant", Sartre mesurait 1 m 57), reconnut enfin "the French philosopher", dont le portrait ornait toutes les gazettes de la côte ouest. Revenus à l’hôtel où résidait l’écrivain, ils entamèrent de longs échanges, qui durèrent plusieurs nuits. Le maître d’hôtel, qui avait fait le débarquement dans l’état-major d’Eisenhower et servait d’interprète, a conté à Contat ces conversations interminables et passionnantes. Généralement, Sartre expliquait d’abord divers aspects de la phénoménologie, puis parlait de Paris, de la Résistance et de lui-même. Puis, vers deux heures du matin, Marilyn prenait les choses en main. Chaque jour, Claude Lanzmann et Jacques-Laurent Bost appelaient de Paris pour que le "pape de l’existentialisme" rentre signer les pétitions contre la guerre d’Algérie. Sartre céda et quitta Marilyn au bout de quelques jours, pour ne plus jamais la revoir.
Ontologie d’un face-à-face
D’un événement si mince, l’auteur parvient à tirer des conclusions à proprement parler sidérantes: c’est un véritable choc tellurique de la pensée qui eut lieu alors. L’ancien et regretté professeur au gymnase du Belvédère (Lausanne, VD) montre d’abord que Sartre fut tout simplement fasciné par Marilyn: cette blonde aux yeux bleus lui rappelait intensément une de ses premières amies, Simone (pas celle que vous pensez, une autre), qui lui avait offert sa petite culotte pour servir d’abat-jour dans la turne que Nizan et lui partageaient à Normale Sup au milieu des années vingt. Mais cette intrusion dans l’être profond se doublait d’une autre: comme lui, la comédienne n’avait pas connu son père, "orpheline livrée au désir des hommes" et ses remarques sur cette condition devaient inspirer Les Mots, que Sartre publia justement quelques années plus tard.
Il faut véritablement parler d’une fascination de Sartre pour la réification vers l’en-soi féminin que représentait déjà Marilyn (la notion de "femme objet", peu sartrienne, n’apparaîtra que plus tard). Laissons parler Contat, au pic de sa démonstration: "elle éveillait l’amour par l’insatiable besoin qui se lisait dans ses yeux au bleu liquide, elle suscitait le désir des hommes, un désir de protection autant que d’immersion dans ce corps de vanille, elle éveillait l’affection de la plupart des femmes et leur désir aussi. (…) une sorte de christ femme, un corps de lumière, une chair irradiante comme le désir même, qui est imaginaire" Un tel déferlement de pratico-inerte ne pouvait amener qu’à une conclusion phénoménale: "la nudité est sa gloire. Mais personne ne peut s’identifier psychiquement à son propre corps: ce sont les autres qui vous en renvoient l’image." Ce fut son drame, le pour-soi se réduisait chez elle à une sorte de pâte d’en-soi.
Le Philosophe l’avait pressenti, et le Commentateur l’accouche: en Marilyn Monroe "il n’y a plus ni dedans ni dehors", comme Sartre le disait si justement à propos de la ville de Naples en 1936.
S.-M. B.
(4.09.1993)
Michel Contat
Les deux orphelins
Sartre et Marilyn
Fayard, 1993, 343 p., Frs 39.80
Les six rendez-vous d'Owen Saïd Markko
C’est l’histoire d’un collectionneur de conversations, l’aventure d’un homme qui change d’identité comme de chemise, le récit d’une errance contrariée, un cri d’amour à Beyrouth, Bruxelles ou Berlin; c’est aussi une valse imaginaire, un manuel d’architecture instantanée, un hymne aux vins lourds et à l’éthylisme léger et les interventions canailles d’une conscience malveillante.
On y croisera un cendrier parlant, un douanier peu honnête, quelques jolies filles, un artiste anxieux, une grammaire en ancien gallois, quelques bouteilles de Chimay bleue et peut-être Joe Dassin.
Michaël Perruchoud casse les codes du récit de voyage et du roman initiatique pour nous offrir une virée délirante, entre échappées absurdes, coups de gueule ciselés et purs moments de poésie.
L'atelier
Les amateurs d’art sont souvent fascinés par le travail des artistes à l’oeuvre dans leur atelier, sans pouvoir toujours pénétrer dans ce sanctuaire. «L’Atelier» lève le voile sur ce lieu où tout se joue, où les artistes se confrontent à leur élan créateur et à leurs oeuvres. Une force se met en mouvement. Francesco Ragusa a remarquablement rendu cette énergie qui donne naissance aux oeuvres.
Entre 2004 et 2007, il a fréquenté les ateliers de 37 peintres et sculpteurs pour les photographier en action. Ces photographies ont été exposées à la Galerie de la Schürra en 2007 et trois d’entre elles dans l’exposition «Artistes fribourgeois contemporains. Fonds d'acquisitions de l'Etat de Fribourg 1984-2009». Les photographies d’ateliers de Francesco Ragusa sont réunies dans ce livre. Elles sont mises en perspective par le texte de Charly Veuthey et admirablement mises en valeur par le graphisme contemporain de Sylvain Aerni.
Photographies de Francesco Ragusa, texte de Charly Veuthey, publié en 2009.
Du marbre au coeur des Alpes
Fascinant matériau, le marbre évoque de prime abord les plus belles réalisations de l’Antiquité. Le Valais, riche en mines pauvres, eldorado éphémère d’explorateurs en tout genre, réservait en ses roches une belle surprise : dès le milieu du XIXe siècle, on découvrit et exploita à Saillon, au cœur des Alpes, une carrière pourvue de tout un panel de marbres jugés dignes des ateliers de Grèce ou de Rome.
Les éditions faim de siècle ont fait paraître en 2009 un premier ouvrage d’Henri Thurre intitulé Du marbre au cœur des Alpes. Histoire de la carrière de Saillon (216 p.). Aujourd’hui épuisé, ce titre fait l’objet en 2014 d’une nouvelle édition destinée au grand public, dans un format modeste (21 X 15 cm, 80 p.) et au prix modique de CHF 10.-. Ce livre contient toutefois toutes les nouvelles découvertes faites depuis 2009 et renouvelle quasiment la moitié de l’iconographie d’origine.
Pendant dix ans, Henri Thurre a mené l’enquête, accumulant informations et documents inédits sur l’histoire et la légende de cette carrière et de ces marbres. Dans ce dernier ouvrage, il évoque les avatars d’une industrie toujours en sursis, les techniques et leurs évolutions, le monde des entrepreneurs et des ouvriers dans un canton toujours en quête de débouchés. De Paris à Aix-la-Chapelle, d’églises locales en villas indigènes, il inventorie tous les usages d’un marbre aux mille facettes.
Avec une préface inédite de Daniel Rausis.
Best-Seller
Si vous croisez un chien qui pourrait être un ange, fuyez!
Heureusement pour le lecteur, les deux amoureux au centre de cette histoire n’ont pas été prévenus et, tout occupés à construire leur carrière professionnelle, ils ne s’interrogent pas sur l’identité du chien errant qui fait irruption dans leur vie.
Dans ce conte tendre et lumineux, Isabelle Flükiger décrit quelques semaines de l’existence d’un jeune couple, qu’elle dissèque d’une plume toujours aussi incisive. Ses deux héros vont découvrir que l’égalité est un leurre, la méritocratie une fiction et, surtout, que la chance est bête à manger des croquettes.
Best-Seller - eBook
Si vous croisez un chien qui pourrait être un ange, fuyez!
Heureusement pour le lecteur, les deux amoureux au centre de cette histoire n’ont pas été prévenus et, tout occupés à construire leur carrière professionnelle, ils ne s’interrogent pas sur l’identité du chien errant qui fait irruption dans leur vie.
Dans ce conte tendre et lumineux, Isabelle Flükiger décrit quelques semaines de l’existence d’un jeune couple, qu’elle dissèque d’une plume toujours aussi incisive. Ses deux héros vont découvrir que l’égalité est un leurre, la méritocratie une fiction et, surtout, que la chance est bête à manger des croquettes.
Saint Georges et le Dragon
"La Foire du Valais (connue sous le nom de Comptoir par les gens du cru) est, une fois par an, une porte ouvrant directement sur l’Enfer, l’antichambre d’un jardin des délices vulgaires, un temple dressé à la gloire de l’alcool, de la débauche et de l’excès, le tout déguisé en salon fréquentable, où des générations de buveurs vont se perdre, dix jours durant, entre les aspirateurs centralisés et les cheminées de salon, et où l’odeur de la barbe-à-papa peine à masquer celles du vomi et de la transpiration, entre le bateau pirate et les animaux de la ferme."
Saint Georges livre son témoignage après trois semaines de cours de répétition dans ladite Foire. Charge à l’arme lourde contre l’Armée suisse, croisement improbable entre journal de campagne et conte illustré, cette première collaboration de deux jeunes inconnus retrace l’histoire d’un soldat sans ambition militaire durant les dix-neuf jours d’un cours de répétition en terrain hostile.
Entre les cheminées de salon et les bars à bière, au cœur de la Foire du Valais, suivez le voyage immobile d’un héros moderne, décidé à faire ce qu’il est demandé de lui: offrir au public la possibilité de comprendre ce que fait l’armée.
Que vous soyez citoyen-soldat ou simple quidam, peu importe: la bêtise transcende les classes sociales.
La plupart des gens tendent à éviter le danger, à contourner la difficulté. Les autres, que l’on appelle braves, héros ou imbéciles, foncent tête baissée dans des situations désespérées, à la recherche du grand frisson, de la gloire ou du bar le plus proche.
Suite de listes
Dans la droite ligne de Listes de listes, Marc Boivin poursuit son exploration toute personnelle du monde avec Suite de listes. Il monte même encore d’un cran dans la qualité et dans l’humour.
Avec Suite de listes, toujours inspirée des listes-répertoires des traditions chinoise et japonaise, l’humoriste bien connu des Dicodeurs, sur la Première, qui fut également un auteur récurrent du Petit Silvant Illustré, continue à recenser les incohérences humaines sous la forme d’un chapelet d’aphorismes, égrené sans temps mort sur une petite centaine de pages.
Suite de listes - eBook
Dans la droite ligne de Listes de listes, Marc Boivin poursuit son exploration toute personnelle du monde avec Suite de listes. Il monte même encore d’un cran dans la qualité et dans l’humour.
Avec Suite de listes, toujours inspirée des listes-répertoires des traditions chinoise et japonaise, l’humoriste bien connu des Dicodeurs, sur la Première, qui fut également un auteur récurrent du Petit Silvant Illustré, continue à recenser les incohérences humaines sous la forme d’un chapelet d’aphorismes, égrené sans temps mort sur une petite centaine de pages.
Liste de listes
Alternant le calembour, la réflexion pénétrante, le jeu de mots habile, il livre une Liste des listes sous forme d’aphorismes parfaitement rythmés qui se déclinent dans 42 sections thématiques : Ce qui est agréable, Choses amusantes , Ce qui pourrait donner envie de tomber amoureux , Sensations bizarres , Inélégances…
C’est court, c’est bon et ça se laisse grignoter avec délectation. Ce "petit ouvrage à feuilleter n’importe où" peut être complété par les lecteurs.
Extrait
Ce qui pourrait donner envie de tomber amoureux
Chez un banquier marié jeune et père de trois enfants, l’approche de la quarantaine.
La conviction acquise que dans les sociétés modernes, le porce n’est plus aussi mal vu qu’autrefois.
Le désœuvrement affectif.
L’envie de souffrir.
L’attrait des emmerdements.
L’obtention de la nationalité.
Une prostituée accordant un rabais.
Une femme blonde plongée dans un livre et qui en tourne les pages.
Une minijupe en laine grise et des bottes en cuir noir.
Feuilleter les pages "chambre à coucher" du catalogue IKEA.
Un dimanche d’hiver au chaud à la maison, quand dehors tout est caché sous la neige.
Liste de listes - eBook
Alternant le calembour, la réflexion pénétrante, le jeu de mots habile, il livre une Liste des listes sous forme d’aphorismes parfaitement rythmés qui se déclinent dans 42 sections thématiques : Ce qui est agréable, Choses amusantes , Ce qui pourrait donner envie de tomber amoureux , Sensations bizarres , Inélégances…
C’est court, c’est bon et ça se laisse grignoter avec délectation. Ce "petit ouvrage à feuilleter n’importe où" peut être complété par les lecteurs.
Extrait
Ce qui pourrait donner envie de tomber amoureux
Chez un banquier marié jeune et père de trois enfants, l’approche de la quarantaine.
La conviction acquise que dans les sociétés modernes, le porce n’est plus aussi mal vu qu’autrefois.
Le désœuvrement affectif.
L’envie de souffrir.
L’attrait des emmerdements.
L’obtention de la nationalité.
Une prostituée accordant un rabais.
Une femme blonde plongée dans un livre et qui en tourne les pages.
Une minijupe en laine grise et des bottes en cuir noir.
Feuilleter les pages "chambre à coucher" du catalogue IKEA.
Un dimanche d’hiver au chaud à la maison, quand dehors tout est caché sous la neige.
Les Domaines de la Sarvaz
La plaine "camarguaise", où le Rhône valaisan vagabondait encore jusqu’à la Première Guerre mondiale, cède sa place dès les années cinquante à un royaume agricole qualifié de "Californie de la Suisse".
Les Domaines de La Sarvaz, de 1925 à 1962 essentiellement, ont joué un rôle de pionniers dans cette métamorphose. Fruit d’une initiative privée réunissant des capitaux et des personnalités du district de Martigny, La Sarvaz SA, sur les terres de Saillon puis de Charrat, a participé à la modernisation de l’agriculture du canton. Au pays des petites propriétés morcelées, l’entreprise voit grand d’emblée avec ses vergers de 100'000 arbres. Présentée dès l’origine comme un des plus beaux domaines du canton, la Sarvaz multiplie les expériences tout au long de la filière commerciale, de la production jusqu’aux premiers dépôts frigorifiques.
Modeste ouvrier agricole sur le domaine de Saillon au sortir de son adolescence, Henri Thurre (1941) retrace les grandes lignes de cette histoire qui toucha des générations de travailleurs de tous les villages de la région, à l’heure où la plaine et l’agriculture connaissent en ce début de XXIe siècle une nouvelle métamorphose.
Du même auteur: Du marbre au coeur des Alpes: histoire de la carrière de marbre de Saillon
